Accueil > Politiques scolaires > Contenus d’enseignement > Éducations à... Ya basta !
 Éducations à... Ya basta !
Éducations à... Ya basta !
dimanche 25 mai 2014, par
[L’actuelle montée en puissance des « éducations à », qui pourrait réjouir (l’école prend en charge des modalités nouvelles d’éducation citoyenne), a de quoi inquiéter : n’a-t-on pas affaire en effet à une forme renouvelée d’offensive contre la transmission scolaire de savoirs… indispensables à l’exercice d’une véritable citoyenneté démocratique ?
Le GRDS a publié sur son site plusieurs textes s’efforçant de réfléchir la relation savoirs/compétences :
* « L’école et les savoirs. À propos d’un ouvrage d’Astolfi », juin 2012
* « La culture commune et la question des compétences. À propos de deux ouvrages de Philippe Perrenoud », juin 2012
* « Compétences : pour comprendre la formation d’un consensus politique », décembre 2012
* « Que faire avec le socle et les compétences ? », mars 2013
Nous accueillons ici une étude d’Alain Beitone (publiée initialement sur le site du GFEN) qui traite sous cet angle des « éducations à », et vient nourrir la réflexion sur le leurre obstiné des « compétences » et le fratras idéologique sous lequel se dissimule le renoncement à une école ambitieuse pour tous : car là est bien, en fin de compte, l’enjeu réel de l’affaire.]
(Résumé)
Le thème des « éducations à » est de plus en plus présent dans le système éducatif : les enseignants et les établissements scolaires sont invités à s’y investir, les dispositifs officiels, les articles de revue et les colloques se multiplient. Il s’agit de répondre à une demande sociale : on attend de l’école qu’elle favorise la santé, la sécurité routière, le développement durable, etc. Mais, au-delà de cet objectif qui semble légitime, les promoteurs des « éducations à » entendent promouvoir une transformation de l’école. On constate en effet que les discours de justification des « éducations à » reposent sur une approche « postmoderne ». La remise en cause de la modernité, de la philosophe des Lumières, des idéaux de l’école républicaine est très présente dans les publications examinées. Cela conduit notamment au relativisme épistémologique, à la remise en cause du rôle de transmission des savoirs de l’école, à la critique des disciplines scolaires. Outre qu’il est contestable sur le plan épistémologique, ce discours sur les « éducations à » fait obstacle à une formation rigoureuse des élèves à propos d’enjeux qui sont pourtant fondamentaux. Cette posture politique et épistémologique conduit à aborder les questions traitées (crise écologique, citoyenneté) sous la forme de débats d’opinion au sein desquels les enseignants sont invités à promouvoir leur conception du bien dans une perspective plus militante que didactique. Par ailleurs, cette approche de l’enseignement, qui prétend traiter de questions transversales avec une classification faible des savoirs mobilisés et un cadrage faible des activités des élèves, constitue une pédagogie invisible dont on sait qu’elle est créatrice d’inégalités d’apprentissage entre les élèves.
« Généreux amis de l’égalité, de la liberté, réunissez-vous pour obtenir de la puissance publique une instruction qui rende la raison populaire »
Condorcet (1791)
« On n’a pas à choisir entre l’obscurantisme et le scientisme »
Pierre Bourdieu (1979)
Les « éducations à » sont à la mode : nombreux textes officiels qui recommandent la mise en place de telles démarches, articles dans des revues de sciences de l’éducation, colloques et assises, ouvrages, formations universitaires, etc. [1]
Même le syndicalisme de l’éducation y va de sa contribution [2]. Le Conseil de l’Europe est aussi très actif dans la promotion de ces « éducations à », et le Conseil Économique Social et Environnemental a consacré récemment un rapport à l’éducation à l’environnement et au développement durable (Bougrain-Dubourg et Dulin, 2013) [3].
Il n’est pas douteux que certains des promoteurs de ce type de pratiques et la plupart des enseignants qui les mettent en œuvre sont animés des meilleures intentions du monde. Il s’agit d’ouvrir l’école sur des problèmes importants : la santé, le développement durable, la citoyenneté, la sexualité, etc. [4] Les promoteurs des « éducations à » souhaitent aussi motiver les élèves, renouveler les pratiques pédagogiques… Qui pourrait s’y opposer ? D’autant que ces défenseurs des « éducations à » se présentent volontiers comme progressistes et critiques : « c’est dans le courant de l’approche critique sociale, que nous situons nos propres travaux » (Lange et Victor, 2006).
Nous voudrions montrer dans ce qui suit qu’au-delà de cette première approche « sympathique » se dissimule un projet de transformation de l’école qui remet globalement en cause à la fois les savoirs et les apprentissages sur fond d’exaltation de la post-modernité et du relativisme [5]. Plus grave encore peut-être, cette logique, qui relève clairement de la pédagogie invisible, est de nature à créer des malentendus source d’inégalité dans les apprentissages.

« Éducations à » et post-modernité
Les « éducations à » ne sont pas une simple méthode ou démarche pédagogiques, pas plus qu’une liste d’objets d’études, elles s’inscrivent dans une réflexion globale sur la société et le système éducatif. Lucie Sauvé situe par exemple sa réflexion sur l’éducation relative à l’environnement dans une opposition entre modernité et postmodernité.
Elle présente ainsi la modernité :
« De façon très générale, la modernité se caractérise par sa croyance au progrès associé à l’explosion du savoir scientifique et aux promesses de la technologie. Elle est le creuset du développement de grandes théories unificatrices et de la recherche de grands principes organisateurs (les -ismes, dont le communisme, le libéralisme, le capitalisme, etc.), porteurs de "valeurs sûres". L’épistémologie moderne est positiviste ; elle s’appuie sur une quête d’objectivité et sur la rationalité instrumentale pour légitimer le savoir et l’organiser en disciplines. L’éthique moderne est anthropocentriste et la liberté de l’individu et de l’entreprise n’a de limite que le respect de la liberté de l’autre. La démocratie est considérée comme l’instrument d’une telle liberté. Les grands espoirs de la modernité, comme ses principaux symboles (pensons au mur de Berlin, entre deux -ismes), s’effondrent progressivement » (Sauvé, 2000) [6]. On le voit, la présentation est à charge. Car il est clair que l’auteure présente les « ismes », « l’épistémologie positiviste », la « rationalité instrumentale » de façon péjorative. Et d’ailleurs, selon elle, les espoirs de la modernité s’effondrent (comme en témoigne l’effondrement du Mur de Berlin !!!).
En opposition à ce tableau très sombre de la modernité, la postmodernité est présentée sous un jour nettement plus favorable :
« La postmodernité est plurielle ; elle se tisse dans la mouvance, l’abolition des ordres antérieurs, le questionnement et la recherche. (…) De façon générale, elle adopte une posture épistémologique relativiste (qui tient compte de l’interaction sujet-objet), inductive, essentiellement critique et socio-constructiviste, qui reconnaît le caractère complexe, singulier et contextuel des objets de savoir ; l’épistémologie postmoderne valorise le dialogue de savoirs de divers types (scientifique, expérientiel, traditionnel, etc.) dont la discipline n’est plus le principe organisateur et dont le critère de validité est la pertinence en regard de la transformation des réalités qui posent problème. Plutôt qu’une justification a priori des choix théoriques et stratégiques, on privilégie la dialectique théorie-pratique et l’évaluation a posteriori des situations. L’éducation postmoderne adopte une posture éthique également relativiste (où le contexte est pris en compte), qui n’est pas a priori anthropocentriste ni individualiste, mais qui correspond à un processus de discussion critique entre les acteurs d’une situation, en vue de fonder des prises de position contextuellement adaptées. La démocratie prend ici un tout autre sens qu’au sein de la modernité : celui d’une négociation pour une participation à la transformation des réalités sociales qui posent problème. La postmodernité tente de ne pas s’enfermer dans de grandes théories explicatives et narratives générales et se méfie des valeurs universelles » (Sauvé, 2000).
Bref, la modernité est rigide et fermée, bardée de certitudes, la postmodernité est souple, plurielle, ouverte, elle ne s’enferme pas dans « de grandes théories », etc. [7] Cette présentation de la postmodernité a cependant le grand mérite de dire tout haut ce que d’autres dissimulent. Par exemple, l’auteure revendique le relativisme tant épistémologique qu’éthique et remet en cause l’organisation du savoir en disciplines (nous y reviendrons). Dès lors le lien entre les « éducations à » et la postmodernité est assez évident. Ces « éducations à » se veulent transversales par rapport aux disciplines, elles visent à l’action et pas seulement à la connaissance, elles portent sur des valeurs et pas seulement sur des savoirs. Autant d’éléments caractéristiques de la postmodernité telle qu’on nous la présente.
La critique du rationalisme de la modernité conduit tout naturellement à des références mystiques et religieuses. Dans le même article, Lucie Sauvé critique le concept de soutenabilité et elle voit un lien entre ce concept et la conception occidentale du temps. Elle ajoute « l’ouverture aux cultures amérindienne ou orientale nous amène à entrevoir une autre approche du temps, qui n’est pas projeté uniquement dans l’avenir, mais qui prend racine dans le passé et est axé sur le présent, où peut se réaliser, ici et maintenant, l’unité des êtres et des choses, en harmonie » (Sauvé, 2000). On est en plein univers New Age ! Mais ce penchant mystique se retrouve chez d’autres auteurs. Par exemple, Antonella Verdiani, docteure en science de l’éducation, déclare dans son intervention aux 3ème Assises de l’EEDD (Lyon-Villeurbanne, 5 mars 2013) : « Une autre vision éducative est donc nécessaire, qui soit intégrale et intégrative, qui prenne en compte à la fois l’individu, la société et la nature. Qui ne fasse pas abstraction de ce que la théorie de la complexité nous a appris, Edgar Morin en premier, sur l’interdépendance universelle que l’on trouve dans toutes les civilisations (chrétienne, bouddhiste, islamique, etc.) et qui a lentement disparu de la modernité » [8]. Il s’agit toujours de s’opposer à la modernité en invoquant « toutes les civilisations » définies en termes religieux.
À cette post-modernité éducative correspond une « Post Normal Science (PNS) ». Se référant à A. Legardez et L. Simonneaux, M. Floro (2013) donne la définition suivante de la PNS : « une science sociale qui place les problématiques humaines au centre de ses préoccupations, se projette dans l’avenir et n’hésite pas à se confronter à l’incertitude de prises de décision urgentes en termes d’enjeux qui engagent le futur de l’humanité » [9].
Les adversaires de la modernité sont présents dans le débat public et ils ont bien le droit (au nom du libéralisme politique que par ailleurs ils combattent) de défendre l’application de leurs idées dans le domaine éducatif. Mais trois remarques s’imposent. La première se réfère aux travaux de Zeev Sternhell (2010) qui a montré, sur la base d’une fascinante érudition, que le discours hostile aux Lumières avait toujours été lié historiquement à des perspectives politiques réactionnaires. Il a aussi rejeté de façon très solidement argumentée le lien établi par certains entre le nazisme et la modernité en démontrant qu’au contraire le nazisme plongeait ses racines idéologiques dans le courant des adversaires de la modernité (adversaires de la Révolution française comme Burke ou Taine et romantisme allemand notamment). La critique du rationalisme, de l’individualisme, de la pensée scientifique appliquée aux questions sociales est une constante des courants politiques anti-républicains qui en appellent volontiers à la Nature et à la Terre (qui ne ment pas comme chacun sait !) contre les « spéculations théoriques » des intellectuels [10]. Les adversaires de la modernité ont certes le droit de s’exprimer, mais nous ne sommes pas tenus de les croire lorsqu’ils se présentent comme progressistes alors qu’ils sont conservateurs voire réactionnaires.
Il faut souligner, en second lieu, que passer la modernité par profits et pertes est très loin de faire consensus chez les philosophes, sociologues et historiens. De nombreux travaux s’efforcent de caractériser la poursuite de la modernité en essayant notamment de préciser les caractéristiques de la « seconde modernité » qui prend naissance au début des années 1960 du siècle dernier. Certains parlent de « modernité radicale », d’autres de « modernité liquide », d’autres encore détraditionalisation [11]. En dehors de cercles très restreints (surtout dans les milieux littéraires) les disciples de J.F. Lyotard sont peu nombreux. Les travaux des sociologues sérieux (dont on peut exclure M. Maffesoli) soulignent au contraire que le mouvement d’individualisation (caractéristique de la modernité) se poursuit. Les luttes en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, la revendication de l’État de droit, la défense du libre exercice de la raison (contre toutes les formes d’obscurantisme), etc. sont toujours au cœur de nombre de luttes sociales et politiques. Il semble difficile de défendre l’idée selon laquelle le projet de la modernité et la philosophie des Lumières, la recherche du progrès social, sont choses désormais obsolètes. Certes, on s’accorde aujourd’hui à faire un bilan critique de la modernité, elle comporte aussi le colonialisme, des formes d’arrogance scientistes dont les effets ont été dévastateurs. Pour reprendre une formule de Ph. Corcuff, les Lumières sont tamisées. Mais ce bilan critique, cette lucidité, ne conduisent pas la plupart des intellectuels et des citoyens à renoncer aux aspirations émancipatrices portées par le projet des Lumières [12].
La troisième remarque concerne les enseignants et les responsables du système éducatif (des chefs d’établissements au ministre en passant par les corps d’inspection). Celles et ceux qui souhaitent s’engager dans les « éducations à » ou qui somment les enseignants de s’y engager sont-ils vraiment solidaires de ce projet de remise en cause de la modernité ? Acceptent-ils d’abandonner les fondements rationalistes de l’activité scientifique ? Refusent-ils tout universalisme en matière éthique ? Acceptent-ils de mettre sur le même plan les opinions et les savoirs ? Veulent-ils vraiment remettre en cause la structuration disciplinaire des savoirs scolaires ? Sont-ils vraiment disposés à jeter aux orties Voltaire et l’affaire Calas, Zola et l’affaire Dreyfus, Jaurès et la défense de l’école publique, Hugo et la séparation des églises et de l’État, Montesquieu et la séparation des pouvoir, Marx et l’étude scientifique du capitalisme ?

« Éducations à » et épistémologie
La question épistémologique est évidemment essentielle dans toute réflexion sur les contenus d’enseignement et les démarches pédagogiques. Les partisans des « éducations à » s’efforcent donc de légitimer sur le plan épistémologique la posture qu’ils préconisent.
Un premier trait saute aux yeux, les références épistémologiques utilisées sont extrêmement fragiles. Par exemple dans ce document :
« Partant d’une réflexion liée à ce domaine, réflexion fortement ancrée dans l’histoire de la science concernée, certains auteurs construisent une philosophie des sciences voire une philosophie telle celle de Bachelard ou celle de Canguilhem. Nous voyons bien ici comment une épistémologie régionale nous semble, dans une première approche, peu adaptée pour les concepts économico-socio-scientifiques du développement durable. L’approche multiréférentielle d’Ardoino (1988), parce qu’elle prend en compte, sans exclusive a priori, des îlots de rationalité liés indifféremment aux champs des sciences de la nature, des sciences sociales, ou des sciences humaines, parce qu’elle s’interroge sur les valeurs impliquées et accepte des zone d’ignorance, semble être plus indiquée dans une perspective de dépassement de cette limite » (Simonneaux, Lange et alii, 2006). On peut avoir du respect pour la réflexion pédagogique de Jacques Ardoino, mais le situer, sur le plan épistémologique au même niveau que G. Bachelard et G. Canguilhem est franchement ridicule [13]. On voit bien que les attaques ciblent des auteurs qui sont porteurs d’une conception rationaliste de l’activité scientifique. Une autre référence épistémologique favorite des partisans des « éducations à » est Edgar Morin. Le thème de la complexité est évidemment cher aux « éducations à ». Mais Edgar Morin n’est absolument pas considéré comme un épistémologue légitime [14]. On chercherait en vain dans les publications des chercheurs reconnus en épistémologie des références aux travaux de cet auteur. E. Morin est typiquement un auteur qui a abandonné depuis très longtemps toute activité scientifique en sociologie. Il a produit un grand nombre d’essais qui échappent à toute procédure de validation par les pairs, il est entouré par un certain nombre de disciples enthousiastes et ses thèses rencontrent les projets de divers acteurs politiques (voir la référence à E. Morin dans la politique éducative de Claude Allègre ou l’utilisation de ses thèses par l’UNESCO). Mais, répétons-le, il ne s’agit absolument pas d’une référence légitime en épistémologie [15].
Quelques articles relatifs aux « éducations à » ont recours à G. Fourez (2003), auteur d’un manuel d’épistémologie destiné aux enseignants, qui n’est pas, lui non plus, le moins du monde un chercheur reconnu en épistémologie. Les tenants des « éducations à » usent et abusent de la référence décorative qui consiste à citer un auteur sans expliciter le contenu de ses analyses dans le but de légitimer leurs thèses, au prix parfois d’erreurs, de contresens et peut-être de manipulations. Passons sur la référence aux travaux d’un certain « Murton » (Simonneaux, 2011) qui est sans doute Robert King Merton dont les analyses sont caricaturées en moins de deux lignes. Dans le même article on trouve une référence à Habermas mobilisé pour rejeter l’idée de vérité. Il s’agit d’un contresens. Habermas (2001 et 2003) est en effet très clair dans sa défense du concept de vérité et dans la distinction qu’il opère entre les débats scientifiques (régulés par une référence à la vérité) et les débats éthiques ou politiques. Dans un autre texte (Lange et Victor, 2006), une référence à Bourdieu est utilisée pour justifier les positions relativistes des auteurs. L’ouvrage de Bourdieu qui est ainsi évoqué est « Science de la science et réflexivité », or ce livre, tiré du dernier cours de P. Bourdieu au Collège de France, est une critique très incisive du relativisme [16]. De même Th. Kuhn est souvent invoqué pour justifier la mise en cause des savoirs scientifiques, alors que cet auteur refusait avec vigueur l’étiquette relativiste que certains tentaient de lui appliquer (Kuhn, 1998).
Au-delà de ces questions de méthodes, deux idées essentielles se dégagent des propos tenus par les adeptes des « éducations à » en matière épistémologique.
La première idée consiste à contester la démarche scientifique et l’existence de connaissances scientifiques. Pour eux, tout cela relève du « positivisme ». Par opposition, ils soutiennent qu’il n’existe pas de connaissance objective, de validité intrinsèque des savoirs scientifiques. Ces derniers sont inséparables des conditions sociales de leur émergence, ils ne peuvent pas être séparés des rapports de pouvoir. D’où la préconisation d’une posture « sceptique » à l’égard des savoirs savants à laquelle les enseignants sont invités. Il y a bien longtemps pourtant que l’épistémologie a fait justice de ce type de discours. Bachelard [17] montrait la stérilité du doute systématique et Bourdieu soulignait que si le champ scientifique est bien, comme tous les champs sociaux, un champ de luttes, il possède des règles spécifiques qui permettent de produire des « vérités transhistoriques » (Bourdieu, 2001). A travers cette critique de la connaissance scientifique et la mise en avant d’une posture relativiste, les tenants des « éducations à » remettent en cause l’idée même de vérité. Or, comme le souligne J.J. Rosat (2009) : « Une théorie de la connaissance doit faire sa place à la distinction entre un énoncé vrai et un énoncé tenu pour vrai : une distinction inscrite dans tout usage du mot « vrai », donc indépendante de tout système épistémique historique, et qui doit être admise par chacun d’eux s’il veut être épistémique, c’est-à-dire un système de connaissances et pas seulement de croyances. Nous voulons pouvoir dire : « Même si les dreyfusards avaient perdu la bataille politique et si la culpabilité de Dreyfus avait été universellement admise ; il n’en resterait pas moins vrai qu’il était innocent ». Quelqu’un qui n’accepterait pas cette phrase et qui récuserait la différence entre la « vérité officielle » (ce qui est cru vrai) et la vérité tout court (ce qui est vrai) ne maîtriserait pas le concept de vérité : il ne saurait pas ce que « vérité » veut dire ».
La deuxième idée est le refus de distinguer les jugements de fait et les jugements de valeur. Pour les tenants des « éducations à », la neutralité axiologique n’est ni possible ni souhaitable. Cette position est évidemment cohérente avec le relativisme proclamé par ailleurs.
Ces deux prises de position ont des implications nombreuses en matière d’enseignement. La première conséquence conduit à rejeter la théorie de la transposition didactique. Pour les « éducations à », il n’y a pas de savoir savant de référence. Ce qui est considéré ainsi n’est (au mieux) qu’un type de savoir parmi d’autres qui sont tous également susceptibles de servir de fondement aux contenus enseignés : « La légitimité des contenus scientifiques qui sont enseignés ne repose plus uniquement sur leur validité. La nature mixte ou métissée, entre sciences de la nature et sciences humaines, des savoirs impliqués par les "éducations à", implique les idées de concepts fourre-tout, tiroirs, carrefours, ou complexes selon la perception qu’on s’en fait. Ces savoirs ne sont donc pas assimilables à un champ disciplinaire particulier. Il en résulte un statut nouveau fortement empreint d’holisme, d’idéologie et de relativisme. Cela amène à se questionner sur les apports et limites de l’épistémologie traditionnelle des savoirs disciplinaires en question dans ce contexte nouveau » (Simonneaux, Lange et alii, 2006).
En cohérence avec ce point de vue, il en découle que les « éducations à » visent moins à permettre aux élèves de s’approprier des savoirs qu’à les conduire à s’engager dans l’action afin de construire un « futur souhaité » : « L’entrée par l’éducation transforme la question didactique de la référence, le savoir savant n’est plus la seule référence, il faut intégrer des pratiques sociales qui, de plus, donnent lieu à débats, controverses en s’appuyant sur des mouvements sociaux ou des événements souvent fort médiatisés. L’éducation n’est donc pas réductible à une acquisition de savoirs, et ne peut donc être contenue dans un module tel que déployé dans les référentiels de formation, mais les « éducations à… » correspondent à un futur souhaité, plus ou moins défini collectivement, et en perpétuelle évolution » (Simonneaux, sd). Comme l’écrivent ces auteurs eux-mêmes, c’est la dimension « idéologique et politique » qui prend le pas sur les savoirs et l’enseignement relève de « l’engagement écopédagogique » : « Dans la manière même de définir les questions environnementales et de développement durable et une éducation qui les concerne, l’emphase peut donc être mise sur leurs dimensions politiques et idéologiques, dans un souci d’analyse critique et d’engagement écopédagogique » (Bader, Barthes, Legardez, 2013).
Dans cette conception politique, voire messianique de l’enseignement [18], il ne suffit pas de « déconstruire les réalités sociales », il faut impulser le changement social : « Au-delà de la déconstruction des réalités sociales, de la recherche des causes des diverses formes d’aliénation, ce type de questions propre à la pédagogie critique ouvre sur l’idée de transformation, de reconstruction. Le savoir-agir ne suffit pas, il importe de développer et de s’approprier un vouloir et un pouvoir-agir face aux situations d’entrave et d’aliénation, en vue d’effectuer les changements qui s’imposent, vers l’émancipation » (Sauvé, 2013). Une telle conception de l’enseignement suppose que l’enseignant est porteur des « bonnes valeurs » qui doivent être transmises, qu’il sait quel est « le futur souhaité » et que les élèves, instruits par leurs maîtres, vont pouvoir faire triompher dans la société les conceptions politiques cohérentes avec les « éducations à » [19]. C’est évidemment renoncer à toute conception de la laïcité, c’est ne pas reconnaître la pluralité des conceptions du bien qui caractérise les sociétés modernes. Tout cela se veut évidemment critique et progressiste : on conteste la théorie économique néo-classique, on dénonce le pouvoir des experts et la marchandisation du monde, on veut libérer les élèves et la société tout entière de l’aliénation et les conduire vers l’émancipation. Il s’agit de substituer à une « science disciplinaire ou académique », une « science engagée » (Lange et Victor, 2006).
Mais ce discours est mystificateur. Comme le souligne J.J. Rosat (2009), le relativisme, par sa remise en cause de l’idée de vérité, par sa contestation de la pensée rationnelle, ne conduit qu’au renforcement de la domination : « Les dominés, en effet, ne peuvent espérer s’émanciper et retourner le rapport de force en leur faveur s’ils n’ont pas la possibilité de l’emporter sur les dominants dans l’espace des raisons : celui de la connaissance du monde et de la société où la seule force est celle des analyses et des arguments. C’est ce qu’avaient compris les Lumières en nouant l’alliance de la connaissance et de la liberté. En détruisant l’espace des raisons, le relativisme dénoue cette alliance et enferme les plus faibles dans le seul espace des rapports de force où ils seront, par définition, toujours les vaincus » [20].
La montée d’une vulgate épistémologique pragmatiste
Dans les travaux relatifs aux « éducations à » les références explicites ou implicites au pragmatisme se multiplient. Voici un exemple de référence implicite : « Les savoirs légitimes ne sont plus seulement ceux qui, construits dans les institutions et par des personnes dont c’est le métier, tiennent leur légitimité du fait qu’ils sont réputés vrais ; les savoirs légitimes sont aussi ceux qui sont utiles et qui marchent et grâce auxquels les individus peuvent agir pour eux et pour la société. Ainsi conçus, les savoirs ne s’éprouvent qu’en situation, en situation d’action. Les savoirs ne sont plus transmis ou appris pour résoudre des problèmes scolaires, mais comme des ressources mobilisables en situation » (Haeberli, 2009).
Autrement dit, un énoncé n’est pas considéré comme vrai ou faux parce qu’il a fait l’objet d’une procédure de corroboration scientifique, il est vrai s’il est utile à l’action à mener. Cela est parfaitement cohérent avec l’épistémologie pragmatiste : « Afin de découvrir la différence entre la vérité et l’erreur, le pragmatisme entreprend une recherche inductive de type socratique sur ce que nous disons de « vrai » ou « faux ». (…) Telle est donc, selon le pragmatisme, la signification des mots « vrai » et « faux ». « Vrai » signifie « servir les buts qui ont conduit à poser la question ». Ou, pour le dire plus précisément : lorsque, poursuivant un but quelconque, nous formons une croyance en rapport avec ce but, la croyance est « vraie » si elle sert la réalisation de celui-ci, et fausse si elle ne contribue pas à sa réalisation » (W. James cité par B. Russell, 1997, p. 140). Ph. Haeberli, dans le même article, cite un rapport pour la Commission européenne publié en 2005 et consacré à l’éducation à la citoyenneté. Ce rapport préconise « l’expression des opinions des élèves sur les objectifs, le contenu et les exigences liés au curriculum ». Ainsi, l’opinion des élèves contribue à définir ce qui doit être enseigné (le curriculum), il n’y a plus de primat du savoir de référence, plus de garantie de la validité des savoirs par une communauté savante, plus de rôle spécifique de l’institution scolaire dans la définition des savoirs enseignés, plus de responsabilité propre du professeur dans la mise en œuvre du savoir dans la classe.
L’épouvantail positiviste
Les articles et communications de colloques consacrés aux « éducations à » dénoncent très fréquemment le positivisme. Il y aurait un enseignement obsolète puisque positiviste, centré sur des connaissances scientifiques établies, soucieux de la vérité des énoncés, de démarches expérimentales, d’épreuves de réfutation, de distinction entre jugement de fait et jugement de valeur. Le terme « positiviste » joue le même rôle que le poumon chez les médecins de Molière ! Il faudrait peut-être rappeler à des chercheurs qu’une règle élémentaire de l’activité scientifique consiste à définir les concepts que l’on utilise [21]. Il faudrait qu’ils nous disent ce qu’est ce positivisme dont vient tout le mal. Lors du colloque consacré au centième anniversaire des « règles de la méthode » de Durkheim, Christian Baudelot et Roger Establet rappelaient que le mot « positivisme » a deux sens. Dans le premier sens, dont ces deux auteurs se réclament, il s’agit « d’appliquer aux faits sociaux les méthodes et les principes des sciences de la nature. Distanciation, objectivation, mesures, construction du fait, administration de la preuve, énoncé d’hypothèses et validation, raisonnement expérimental… ». Dans le second sens (rejeté par Baudelot et Establet) le positivisme se situe dans la tradition d’A. Comte et Cl. Bernard et consiste à établir par induction des lois générales qui régissent les différentes sociétés. Les partisans des « éducations à » sont donc positivistes au sens 2 (ils font l’éloge de l’induction) et anti-positivistes au sens 1 (ils rejettent la démarche expérimentale, l’objectivation, etc.). Il faut souligner que nombre d’auteurs dénoncés comme « positivistes » par les tenants des éducations à (Bachelard, Popper, Marx, etc.) ont pris position contre le positivisme (qu’il s’agisse du positivisme d’A. Comte dénoncé par Marx ou du positivisme logique critiqué par Popper). Précisons pour en finir sur ce point que le grand philosophe J. Bouveresse (2012), défenseur inébranlable de la raison, n’a cessé d’expliquer que si le positivisme devait être soumis à un examen critique, le terme ne devait pas être utilisé comme une injure. Mais les défenseurs des « éducations à » ont-ils seulement entendu parler de J. Bouveresse (à défaut de le lire) ?

« Éducations à », savoirs et disciplines
Les « éducations à » sont fondées sur des savoirs qui ne sont pas assimilables « à un champ disciplinaire particulier » (Simonneaux, sd). Ce genre d’affirmations, fréquentes dans la littérature sur ce thème, est à la fois un constat et un souhait [22]. Les adeptes des « éducation à » n’aiment pas les disciplines, qu’il s’agisse des disciplines savantes ou des disciplines scolaires. Elles ne permettent pas, selon eux, de rendre compte de la complexité du monde, elles reposent sur une conception « verticale », elles sont trop « neutres », etc. En bref, elles visent à instruire les élèves alors qu’il faut les éduquer : « Face à une vision de l’enseignement perçu comme l’instruction c’est-à-dire la transmission de savoir-objets établis, l’éducation importe dans l’école des opinions et une forme de subjectivité. C’est ici l’inverse d’une disciplinarisation des savoirs qui tend à les rendre figés et neutres. Le traitement de questions sociales pourrait être analysé alors par certains comme la perte d’une pseudo-neutralité du système scolaire, pseudo-neutralité établie notamment à partir d’un enseignement scientifique considéré comme neutre car rationnel et donc universel » (Simonneaux, sd).
Cette remise en cause des disciplines et des savoirs qu’elles véhiculent fait l’impasse sur deux éléments essentiels.
D’une part les disciplines savantes sont le lieu de la production et de la validation des savoirs. Les disciplines sont un fait et non le produit d’un quelconque complot. Ce fait repose sur une raison simple, la masse des savoirs produits s’accroit de façon exponentielle. L’idéal de l’honnête homme maîtrisant tous les champs du savoir tel Pic de la Mirandole est révolu. Seul un spécialiste d’une discipline peut évaluer les travaux d’un autre spécialiste de la discipline. C’est pourquoi le processus de spécialisation ne cesse de s’approfondir. En mathématiques, un spécialiste d’analyse aura beaucoup de mal à évaluer un article de recherche en géométrie et, en histoire, un spécialiste d’histoire de la Grèce antique ne pourra siéger de façon crédible dans un jury de thèse d’histoire contemporaine.
Ce processus n’est pas exclusif de processus d’hybridation, mais on voit alors émerger un nouveau champ disciplinaire (la sociohistoire ou la biochimie). Il n’est pas exclusif non plus de recherches co-disciplinaires dans lesquelles des spécialistes qui se définissent par la maîtrise de leur champ disciplinaire respectif, conjuguent leurs efforts pour rendre compte d’un objet particulier (on peut penser par exemple aux programmes de recherche communs d’économistes, de sociologues, de psychologues et de juristes à propos du travail ou des relations professionnelles). Mais cette activité co-disciplinaire implique que les chercheurs soient « pointus » dans leur domaine de compétence. Il est totalement illusoire de rechercher la production d’un savoir total sur « le vivant », sur « la nature » ou sur « la société ».
C’est bien en vain que les adeptes de la « complexité » invoquent le fait que, dans la réalité, il n’y a pas de découpage disciplinaire. Un verger est à la fois une réalité économique, sociale, géologique, botanique, etc. Mais précisément, une connaissance qui ne soit pas superficielle exige que cet objet total soit examiné de plusieurs points de vue disciplinaires spécifiques car aucun chercheur ne maîtrise suffisamment les concepts et les méthodes de chacune discipline dont la mobilisation est nécessaire. C’est donc la complexité même qui implique la spécialisation disciplinaire et le renoncement à l’illusion du savoir total.
D’autre part, les disciplines scolaires, qui sont beaucoup moins spécialisées, impliquent des professeurs qu’ils se forment dans diverses disciplines savantes (la civilisation et la littérature pour les professeurs de langues, l’algèbre et les probabilités pour les professeurs de mathématiques, la géographie physique et l’histoire médiévale pour les professeurs d’histoire et de géographe, la science économique et la sociologie pour les professeurs de SES). Mais dès lors que l’on considère que les professeurs des écoles, des collèges et des lycées sont les garants de la validité épistémologiques des savoirs qui sont à l’œuvre dans leur classe, ils doivent disposer d’une formation exigeante dans les disciplines savantes auxquelles ils doivent faire référence. Cette maîtrise des savoirs de référence est la condition nécessaire (mais pas suffisante) de la légitimité des professeurs des enseignements scolaires. C’est ce qui fonde le rôle essentiel de la recherche et de l’enseignement supérieur dans la formation initiale et continue des enseignants du premier et du second degré (général, technologique et professionnel).
Remettre en cause l’organisation disciplinaire des savoirs revient donc, sur le plan de la recherche, à remettre en cause l’autonomie du champ scientifique et le principe de l’évaluation par les pairs et, du point de vue de l’enseignement scolaire, à remettre en cause la fonction de transmission des savoirs de l’école et la légitimité des enseignants.
L’idée selon laquelle les enseignants seraient des animateurs [23], ne disposant pas des savoirs que les élèves doivent s’approprier et les découvrant avec eux est évidemment destructrice. Tel est pourtant bien le projet des « éducations à ». Préfaçant le livre d’Edgar Morin, le directeur général de l’UNESCO, Federico Mayor (1999), n’hésitait pas à écrire : « nous devons abattre les barrières traditionnelles entre les disciplines et concevoir comment relier ce qui a été jusqu’ici séparé ». Cette posture a-disciplinaire des tenants des « éducations à » les conduit à reprocher aux enseignants leur attachement aux savoirs et aux disciplines. A propos de l’enseignement agricole et du développement durable, J. Simmoneaux écrit : « L’introduction de l’actualité, de questions sociétales, de controverses, d’incertitudes peut être perçue par certains enseignants comme contradictoire à un programme et des savoirs établis » (Simonneaux, sd). Il est clair, pour cet auteur que l’attachement aux savoirs établis et aux disciplines est un obstacle qu’il faut franchir pour permettre aux « éducations à » de s’épanouir.
Quant à Nicole Tutiaux-Guillon, elle étudie le comportement des professeurs d’histoire et géographie à propos de l’éducation au développement durable et constate qu’ils voudraient passer par « l’apprentissage de savoirs solides et avérés » : « En effet ce qui fait largement obstacle à l’ÉDD pour les enseignants d’histoire-géographie, ce sont les dimensions politique, éthique et comportementale de cette éducation : les enseignants se refusent à ce qu’ils perçoivent comme un endoctrinement et refusent une éducation comportementale ; la formation du citoyen est invoquée et surtout l’attitude critique face aux médias, mais ceci passerait par l’apprentissage de savoirs solides et avérés, ce qui est fort difficile sur le développement durable » (Tutiaux-Guillon 2011). Le risque selon elle c’est la disciplinarisation de l’éducation au développement durable : « La « disciplinarisation » de l’ÉDD dans les manuels et les projets des enseignants, c’est-à-dire la reconfiguration des contenus relatifs à l’ÉDD (tout ce que l’élève doit acquérir, qu’il s’agisse de savoirs ou de finalités) selon les normes de la discipline scolaire, telles qu’elles ont été mises en évidence dans de nombreux travaux de didactiques antérieurs (principalement par F. Audigier et N. Tutiaux-Guillon). Cette disciplinarisation aboutit à perdre le rapport au contexte politique et la signification sociale de l’ÉDD (ce qui est pourtant à l’origine de sa prescription comme éducation à) puisque tout ce qui est enjeux politiques et débats de société est effacé » (Tutiaux Guillon 2011) [24].
Certains chercheurs, cependant, s’inquiètent de la remise en cause des savoirs disciplinaires. C’est le cas de Denise Orange Ravachol (2013). Dans une communication consacrée à cette question, elle craint que les « éducations à » ne conduisent à une « mise à mal des principes qui structurent le savoir ».
L’importance de la maîtrise des savoirs peut être soulignée à la lecture de divers articles favorables aux « éducations à » qui prétendent s’intéresser à l’enseignement de la dimension économique du développement durable. Les auteurs ne sont pas économistes mais sociologues, spécialistes des sciences de la vie ou chercheurs en sciences de l’éducation coupés depuis longtemps de tout ancrage disciplinaire. Mais comme l’économie est l’une des trois dimensions du développement durable, il est difficile de faire l’impasse sur cette discipline. Dans l’article de Alpe et Legardez (2011) les auteurs analysent spécifiquement les questions économiques, mais les économistes auxquels ils font référence (Vauban, Malthus, Ricardo, Jevons, Marx) sont de économistes dits classiques qui n’ont pas spécifiquement traités du développement durable [25] (et pour cause, ils écrivaient aux XVIIIe ou XIXe siècles !). Par contre, aucun des auteurs majeurs contemporains n’est évoqué. Pour s’en tenir aux économistes français on pourrait citer R. Guesnerie, O. Godard, J. Ch. Hourcade, Ch. de Perthuis, K. Schubert, E. Laurent, G. Rotillon, P. Crifo, etc. Pas un seul n’est cité. Plus surprenant encore, le rapport Stern, qui est au cœur des réflexions sur les politiques de développement durable (avec notamment la question du taux d’actualisation), n’est pas évoqué non plus. Aucun élément précis n’est apporté sur l’analyse économique du développement durable et les politiques environnementales (fiscalité, marchés de quotas, réglementation). Le contenu des programmes de SES est expédié en quelques lignes avec ce jugement sans appel : ils seraient dominés par le « modèle de la régulation libérale par le marché ». Ces programmes ont été rédigés sous l’autorité de Jacques Le Cacheux (OFCE) qui est aussi l’un des spécialistes français de l’analyse économique de l’environnement et du développement durable. Quand on connait ses travaux, on ne peut pas sérieusement le présenter comme un ultra-libéral apologiste du règne sans partage du marché.
Ce premier exemple suffit à montrer l’importance de la maîtrise des savoirs de référence dans le domaine dont on veut traiter. Un autre article illustre cette impossibilité à traiter d’un domaine dont on ne maîtrise pas les savoirs disciplinaires de référence (Simonneaux, 2007). Le titre de l’article ("Les enjeux didactiques des dimensions économiques et politiques du développement durable") affiche pourtant la volonté de traiter de questions économiques. Mais là encore les auteurs de référence ne sont pas évoqués, seuls un petit ouvrage de vulgarisation (F.D. Vivien, 2005) et un manuel universitaire (B. Bürgenmeier, 2008) sont cités. Plus loin, à propos de l’économie du développement, Ph. Hugon est évoqué. Mais, pour le reste, les auteurs utilisés ne sont pas légitimes dans le champ de l’analyse économique de l’environnement (S. Latouche, J. Gadrey, A. Lipietz [26]). J. Simonneaux se pose une question révélatrice : « Peut-on qualifier l’idéologie du développement durable de néo-libérale puisque ses références théoriques s’appuient fortement sur des concepts d’économie néo-classique ? ». Tous les économistes savent que Walras, le fondateur de l’approche néo-classique, était socialiste, que nombre de publications néo-classiques visent à montrer les limites drastiques de la régulation par le marché et la nécessité de l’intervention de l’État, que J. Stiglitz par exemple, pourfendeur du libéralisme économique, utilise dans ses travaux un appareil analytique néo-classique (tout comme P. Krugman). Confondre « néo-classique » et « libéraux » est une erreur que le jury du CAPES ne pardonne pas à ceux qui souhaitent devenir professeur de SES… [27] mais on trouve cette erreur dans une revue publiée par les Presses de sciences po !
Un dernier exemple de confusion liée à la maîtrise insuffisante des savoirs disciplinaires est fourni par un article consacré aux relations entre enseignement de l’économie et citoyenneté (Simonneaux, 2006). L’auteur écrit : « Peut-on demander à un élève de raisonner à un moment sur des principes de citoyenneté (coopération, justice, égalité...) et, une fois entré en cours d’économie, sur des principes de marché (concurrence, primauté de l’intérêt individuel…) sans confronter à un moment ces deux modes de raisonnement ? ». Passons sur le fait qu’il est étrange de confronter la citoyenneté (qui constitue un statut juridique auquel correspond un certain nombre de droits) et une discipline (scolaire ou savante selon le cas) qui ne peut se définir que par un ensemble de savoirs et de méthodes d’investigation. Passons aussi sur le fait que l’auteur semble considérer que « citoyenneté » et « économie » s’opposent. Limitons-nous aux thèmes qu’il évoque. Il semble ignorer que, depuis le début des années 2000, dans le cadre de la discipline scolaire « sciences économiques et sociales » la question de la justice est au programme et par conséquent la question de l’égalité. Il semble ignorer qu’il existe de très nombreux travaux dans le domaine de l’économie de la justice : Gamel (1992), Fleurbaey (1996), Piketty (2008) [28], Fleurbaey (2006), Clément, Le Clainche et Serra (2008), Sen (2012a) , Sen (2012b) [29], Piketty (2013). Il n’est donc pas possible d’opposer la « citoyenneté » qui s’intéresserait à la justice et à l’égalité et la science économique qui ne s’y intéresserait pas. De plus, J. Simonneaux place la coopération du côté de la citoyenneté et pas du côté de l’économie. Faut-il rappeler que le prix Nobel de science économique a été attribué à Elinor Ostrom et que ses recherches portent notamment sur la coopération ? Plus généralement, la coopération est l’un des modes de coordination analysé par les économistes (aux côtés notamment du marché et de la hiérarchie) [30]. Au fond ce que révèle cet article, c’est que l’auteur considère que l’économie est du côté des intérêts égoïstes et la citoyenneté du côté de la solidarité. Ce poncif peut-il vraiment servir de base à un enseignement, fut-ce une « éducation à » ?
Il est tout à fait normal de ne pas tout connaître dans tous les domaines. C’est bien pourquoi il y a des disciplines de recherche et d’enseignement. Mais les défenseurs des « éducations à » prétendent justement dépasser les disciplines, produire un discours total embrassant la complexité du monde, intégrant les faits et les valeurs. Ce qu’ils écrivent montre qu’il s’agit d’une tâche impossible, puisque eux-mêmes se révèlent incapables de traiter des disciplines dont ils ignorent le contenu. On comprend la perplexité, voire le désarroi, des professeurs de SVT que l’on met en demeure de traiter des « questions de société » et même d’en faire le point de départ de leurs enseignements. Ils ne sont pas en mesure de traiter de questions économiques, de même que les professeurs de SES sont incapables de traiter de la tectonique des plaques ou de la génétique. On peut sans doute présenter une communication dans un colloque sur un domaine où l’on ne connait pas grand-chose (dès lors que les autres communicants n’en connaissent pas davantage), mais on ne peut pas enseigner sérieusement à des élèves des savoirs que l’on ne maîtrise pas. On s’étonne d’avoir à rappeler une telle évidence.
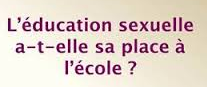
« Educations à » et débats
Les « éducations à » préconisent le recours au débat comme modalité pédagogique centrale : « Le DD demande donc de déconstruire les modèles classiques d’enseignement, fondés sur la transmission de vérités normées, sans controverse » (Floro, 2013). Cet apprentissage du débat est justifié par la remise en cause de la transposition didactique et par la nécessité de conduire les élèves à se forger une « opinion raisonnée » : « Dans le cadre théorique curriculaire, pour penser les actions éducatives non disciplinaires telles que les « éducations à », c’est moins aux idées de transposition didactique, ou de résolution de problèmes que l’on doit faire appel, qu’aux notions de pratiques de référence et de construction d’une opinion raisonnée. (…) Cette élaboration ne peut se faire qu’au moyen d’une interdisciplinarité mettant en œuvre des pratiques concrètes de négociations et par le moyen de l’apprentissage au débat » (Lange et Victor, 2006).
Puisqu’il n’est plus question d’enseigner des « savoirs établis », puisque les sciences ne sont pas séparables de l’idéologie, puisque le monde est marqué par des « controverses socio-scientifiques », il faut donc débattre en classe. Le débat permettant à la fois de confronter les opinions (démocratie) et d’acquérir des savoirs. Le débat permet aussi de dépasser l’enseignement traditionnel afin de passer à un « enseignement systémique » [31]. D’après Arnaud Diemer (2013), l’enseignement traditionnel se situe du côté de l’objectivité : « L’enseignant est le garant d’une certaine objectivité : rapport des faits et des théories mobilisées » ; alors que dans l’enseignement systémique qu’il appelle de ses vœux et qu’il relie à l’éducation au développement durable, l’enseignant se situe du côté de « l’éveil des consciences » : « L’enseignant introduit des débats, des questions vives, une certaine curiosité : nouvelle vision du monde, nouveau mode de pensée, interactivité ». Dans cet enseignement systémique, il faut « laisser les élèves acquérir les faits et les concepts à leur propre rythme ». Tout cela est bel et bon, mais d’une part cela ne fonctionne pas, d’autre part cela repose sur des confusions.
Cette démarche pédagogique, qui conduit à débattre des questions socio-techniques, est inefficace du point de vue des apprentissages des élèves. C’est une chercheuse favorable à ce type d’approche qui le constate. Analysant la conduite de débats sur des questions liées au développement durable dans plusieurs classes en Suisse, N. Fink (2010) en arrive à la conclusion suivante : « le recours explicite à des savoirs et des outils de pensée relevant des disciplines de sciences sociales est majoritairement absent. Les informations mobilisées et les propositions énoncées sont pourtant nombreuses. Mais elles relèvent le plus souvent d’une sorte de sens commun hétérogène et peu organisé ». En bref, le débat part du sens commun et y reste. Cette remarque n’est pas isolée. Dans un autre article portant sur la même recherche, Fink et Audigier (2011), analysant un débat en classe, soulignent : « du côté des élèves, nous observons des ignorances obstacles, c’est-à-dire que ceux-ci expriment une idée générale que le manque de connaissances précises empêche de développer ». Alors que les partisans des « éducations à » ne cessent de relativiser l’importance des savoirs, alors qu’ils reprochent aux professeurs de s’accrocher aux savoirs disciplinaires, on constate dans la pratique du débat en classe que, faute de connaissances précises, structurées, validées, la discussion s’enlise et ne permet pas aux élèves d’accéder à un niveau supérieur de compréhension.
Tous les chercheurs ne sont pas aussi prudents que Fink et Audigier. Dans une autre recherche portant sur un débat à propos du changement climatique (Albe, 2010-2011), on constate que le dispositif de débat conçu par les chercheurs met sur un pied d’égalité les analyses du GIEC et celles des climato-sceptiques. Or les élèves n’ont pas les moyens de valider ou d’invalider les conclusions du GIEC. Mais, dès lors que l’on refuse de reconnaître quelque légitimité que ce soit au savoir scientifique, tout se vaut. Bien mieux : les élèves sont invités à se prononcer sur le protocole de Kyoto, or il serait tout à fait étonnant que les élèves maîtrisent les analyses économiques qui permettraient de discuter de façon éclairée du protocole [32]. L’auteure se réjouit du fait que, dans le cours du débat, les élèves procèdent à « une remise en cause du caractère-empirico réaliste des sciences ». En conclusion elle juge que le débat a atteint ses objectifs car les élèves ont abordé la question du réchauffement sous l’angle politique [33]. Elle ajoute : « Il s’agit de rendre les élèves plus vigilants et moins dominés par l’autorité de la science et des experts ». Le débat n’a donc absolument pas permis aux élèves de progresser dans la construction d’un savoir structuré sur le réchauffement climatique, mais là n’était pas l’objectif. Il s’agissait de promouvoir le relativisme épistémologique, de jeter la suspicion sur les scientifiques, nommés par les gouvernements et payés par eux, ce qui conduit « logiquement » à ce que les citoyens doivent se méfier de leurs conclusions.
Le débat, tel qu’il est préconisé par les tenants des « éducations à », est donc cohérent avec leurs options épistémologiques relativistes. Sur le plan pédagogique et didactique, cette conception du débat repose sur une confusion. Par exemple B. Urgelli (2012) écrit : « Les pratiques d’éducation aux questions socio-scientifiques montrent une diversité de vision des enjeux d’apprentissages, entre une vision positiviste et républicaine de l’instruction, centrée sur la transmission de savoirs stabilisés, et une vision constructiviste et critique de l’éducation citoyenne soulignant la pluralité des points de vue et favorisant les débats sur les enjeux ». Il y aurait donc d’une part une conception positiviste et républicaine [34] (obsolète dans l’optique des « éducations à ») qui refuse tout débat et d’autre part une vision « constructiviste et critique » qui favoriserait le débat. Mais le problème est ici très mal posé.
Ce qui importe c’est de préciser le type de débat que l’on entend mettre en œuvre [35]. Il existe des débats scientifiques et il est très important, du point de vue de la formation des élèves à l’esprit scientifique, de souligner l’importance des controverses dans l’histoire des sciences. Si la science est une longue suite d’erreurs rectifiées, c’est sur la base de débats entre pairs qui soumettent leurs énoncés à réfutation, qui passent au crible de la critique la cohérence interne des analyses (Berthelot, 2008). Le « débat scientifique dans la classe » permet donc aux élèves de s’approprier les règles du champ scientifique, de mettre en œuvre une démarche d’investigation-structuration dont l’objectif est évidemment de parvenir à la formulation d’énoncés vrais au regard du savoir-savant. Dans ce type de démarche pédagogique, les élèves ne confrontent pas des « opinions », mais des arguments formulés sur la base d’une investigation (recherches documentaires, expérimentation, etc.). Le professeur n’est pas un animateur du débat, il est le garant de la validité épistémologique des savoirs mis en œuvre dans la classe. Il a aussi la responsabilité, à l’issue de la démarche d’investigation, d’institutionnaliser les savoirs appris, de désigner clairement quels sont les savoirs que les élèves doivent s’approprier. D. Orange-Ravachol (2010) en donne un exemple à propos de l’explication du volcanisme.
Ce type de débat doit être soigneusement distingué des débats éthiques et politiques. On peut expliquer par quels mécanismes chimiques ou biologiques la pilule RU 486 fonctionne comme « pilule du lendemain », on peut étudier le processus scientifique qui a conduit E.-E. Baulieu à faire cette découverte, on peut s’interroger sur les limites de l’efficacité de ce produit. Ce sont là des questions de faits, qui relèvent du débat scientifique. La question : « Est-il moralement acceptable d’utiliser cette pilule ? » relève d’un débat éthique qui ne doit absolument pas être confondu avec le précédent. De même, on peut identifier par quels processus physiques et chimiques l’usage de combustible nucléaire produit des déchets à vie longue. C’est une question de fait. Compte-tenu des savoirs ainsi produits, faut-il ou pas prendre le risque du recours au nucléaire qui implique le stockage de ces déchets à vie longue ? Il s’agit là d’une question politique. Les citoyens, au nom de leurs opinions, ne peuvent pas déterminer la durée de la demi-vie de tel ou tel déchet nucléaire. Par contre, il leur appartient de dire s’ils acceptent ou pas que l’on prenne le risque de stocker de tels déchets. La délibération démocratique suppose donc l’information scientifique et l’indication du degré d’incertitude des connaissances scientifiques mobilisées. C’est le principe des « jurys citoyens » qui délibèrent sur des questions sociales ou politiques controversées, mais qui sont d’abord informés par des experts sur les données scientifiques et techniques de la question qu’ils doivent trancher. C’est donc la notion même de « question socio-scientifique », très utilisée par les partisans des « éducations à », qui doit être rejetée parce que précisément, elle confond les questions de faits et les questions de choix politiques et éthiques [36].
Le débat scientifique dans la classe est parfaitement légitime comme modalité d’accès au savoir des élèves. La formation des élèves au débat démocratique dans le cadre de l’école est elle aussi une pratique nécessaire. Si l’on considère que la délibération, l’échange public d’arguments fondés en raison, sont très importants pour la démocratie, alors l’école doit, dans une perspective égalitaire, former les élèves à la pratique de ce type de débat argumenté. Elle doit aider tous les élèves à acquérir les compétences argumentatives leur permettant d’exercer une citoyenneté active. C’est dans cette perspective que l’ECJS a été mise en place initialement [37]. Il s’agissait précisément de pratiquer en classe le débat argumenté à propos de questions controversées sur le plan social, éthique ou politique.
Il s’agit là de deux types de débats très différents. En les confondant, les défenseurs des « éducations à » prennent le risque à la fois de nuire aux apprentissages des élèves et de saper la démocratie par la création d’un climat relativiste.

« Éducations à », pratiques pédagogiques et pédagogie invisible
Les tenants des « éducations à » ne s’en cachent pas, le développement de ce type de démarche constitue pour eux un levier pour transformer l’ensemble du système scolaire : « Les « éducations à » renouvellent également les pratiques scolaires coutumières par la place qu’elles accordent au débat, à l’interdisciplinarité et au partenariat » (Lange et Victor, 2006). Pour eux, l’évolution de la société conduit à définir trois postures différentes à l’égard de l’école :
« Dans un monde en mutation, incertain, imprévisible, on peut distinguer trois conceptions du rôle de l’école. La garder à l’abri des questions politiques, la préserver comme un sanctuaire protégeant les enfants des soubresauts de la société. L’école tire sa légitimité de savoirs conçus selon un mode patrimonial, c’est-à-dire un héritage transmis de génération en génération. Au risque de creuser le fossé se manifestant entre le monde scolaire et des cohortes d’élèves de plus en plus étrangères à celui-ci.
Ou bien prolonger les pratiques coutumières de l’enseignement de savoirs disciplinaires et, en fin de séquences, ouvrir sur des questions de sociétés avec l’objectif de donner du sens à des apprentissages qui en manquent cruellement aux yeux des élèves.
Enfin, prendre au sérieux ces éducations à et entrer par les questions de société, ce qui nécessite d’accepter aussi une légitimité sociale aux contenus abordés à l’école. Si nous retenons cette dernière possibilité, les changements pour l’école sont importants : engagement dans des projets éducatifs globaux et des actions au niveau des établissements, avec de nouvelles modalités d’apprentissage, de nouveaux rapports au savoir, au monde et à l’autre » (Victor et Lange, 2012).
C’est évidemment la troisième option qui est retenue. Tout se passe comme si, les disciplines scolaires étant des pôles de résistance au changement, les « éducations à » fonctionnent comme une stratégie de contournement pour faire prévaloir une conception postmoderne du rapport au savoir.
Outre qu’elle est contestable sur le plan épistémologique et politique, cette nouvelle conception que l’on tente d’imposer aux enseignants est nuisible pour les apprentissages des élèves. Dès la fin du XIXe siècle, E. Durkheim s’inquiétait de l’influence au sein de l’école « … d’un genre particulièrement bâtard, qui consiste à combiner les idées comme l’artiste combine les images et les formes, pour charmer le goût et non pour satisfaire la raison, pour éveiller des impressions esthétiques et non pour exprimer des choses » (Durkheim, 1895, cité par Pinto, 2014). Or, pour Durkheim, il faut au contraire former les élèves à « l’exactitude dans l’analyse » et à « la rigueur dans la preuve ».
Ces remarques de Durkheim gardent toute leur actualité. Les travaux contemporains de sociologie de l’éducation, dans le prolongement notamment des travaux de B. Bernstein [38], soulignent que le développement de la « pédagogie invisible » est un facteur important de création d’inégalités entre les élèves en matière d’apprentissages.
Il faut signaler tout d’abord que les « éducations à » et plus généralement la doxa pédagogique qui s’est imposée au sein du système éducatif, modifie le statut des enseignants et du savoir : « Là où il y avait asymétrie dans les prises de parole parce qu’il y avait savoir chez le maître, ignorance chez les élèves, la relativisation des savoirs, accompagnée de la vulgate constructiviste des apprentissages, constitue le maître en organisateur, puis animateur, d’un dispositif pédagogique et en quasi égal des élèves dans les échanges » (Bautier et Rayou, 2009, p. 82). Il ne s’agit pas de défendre une supériorité ou un statut social du professeur. Ce qui est en jeu ce sont les apprentissages des élèves. Bautier et Rayou soulignent que ce qui se met en place c’est « un cadrage faible où enseignant et élèves se situent sur un même plan », ce qui va de pair avec « un affaiblissement des interventions didactiques et de l’institutionnalisation des savoirs » (idem, pp. 82-83).
Dans le cadre d’une réflexion sur l’école démocratique, É. Bautier (2010), situe clairement les enjeux de cette remise en cause des savoirs disciplinaires au profit d’une approche « curriculaire » : « Cependant ces évolutions s’affirment aussi dans un affaiblissement des logiques et matrices disciplinaires au profit de matrices curriculaires prenant en compte ces nouveaux contenus, leurs mises en scènes pédagogiques et leurs mises en forme langagières. Outre une grande invisibilisation de la hiérarchie sociale des savoirs, elles s’accompagnent d’une hiérarchie également moins visible entre les apprentissages des savoirs, des valeurs et la formation d’un sujet autonome, hiérarchie moins visible pour les élèves, mais aussi moins évidente pour les enseignants. Ces derniers font alors des choix, souvent à leur insu, ont des pratiques différentes en fonction de leur propre hiérarchisation négociée avec eux-mêmes ou les élèves, consciemment ou non, de leur propre « aisance » à articuler les différents domaines, à les faire valoir auprès des élèves. Les élèves ne peuvent alors qu’être dans la difficulté pour identifier ce que sont les savoirs à acquérir, ce que sont les exigences de l’École, et surtout ses visées ». Elle précise : « Les travaux de sociologie des apprentissages et des inégalités (ceux Bernstein, ceux d’Escol, de Bonnéry, Bautier, Rochex, en particulier) ont cependant montré que l’affaiblissement disciplinaire et la transversalité des savoirs et compétences à mobiliser dans des tâches scolaires, qui correspondent à une classification et à un cadrage souvent faibles des savoirs et des situations de travail cognitif, pénalisent les élèves de milieux populaires peu familiers de ces mobilisations implicites, de cette circulation dans des univers de connaissances et de pensée hétérogènes et qui supposent une familiarité avec des usages littéraciés du langage qui les secondarisent » (Bautier, 2010) [39].
C’est donc le caractère « multiréférentiel » des « éducations à » qui est pour les élèves une source de difficultés, car ils doivent décider seuls, dans le cadre d’échanges d’arguments plus ou moins structurés, de ce qui doit être retenus, relié à d’autres savoirs, ils sont incités à confondre jugement de faits et jugements de valeurs, ils ne sont pas formés à la hiérarchisation des savoirs et des références (puisque les « éducations à » contestent cette hiérarchisation). L’un des malentendus essentiels, c’est que les élèves pensent alors que par l’expression de leurs opinions et de leurs expériences, ils satisfont aux attentes du système scolaire. Or, il arrive toujours un moment dans leur cursus, où c’est la maîtrise des savoirs constitués qui sert à évaluer les élèves. De ce fait, certains d’entre eux vont découvrir (souvent avec un sentiment d’injustice) que leur subjectivité ne suffit pas et qu’il existe des connaissances validées par des communautés savantes qu’il faut acquérir au prix d’un travail intellectuel exigeant.
Conclusion
En fin de compte, les promoteurs des « éducations à » ne dissimulent pas leur objectif. Il s’agit de promouvoir une conception de l’éducation qui « se différencie ainsi nettement du projet coutumier de l’école républicaine » (Bader, Barthe et Legardez, 2013). Et en effet, la posture à la fois relativiste et normative des « éducations à » est en rupture avec la tradition républicaine en matière d’éducation telle qu’elle était formulée par Condorcet : « La puissance publique ne peut même, sur aucun objet, avoir le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités ; elle ne doit imposer aucune croyance (…) Son devoir est d’armer contre l’erreur, qui est toujours un mal public, toute la force de la vérité ; mais elle n’a pas le droit de décider où réside la vérité, où se trouve l’erreur » (Condorcet, 1791/1994, p. 88).
L’école, disait en substance Condorcet, n’a pas à enseigner un catéchisme quel qu’il soit, fut-ce un catéchisme républicain. Le rôle de l’école c’est de former les élèves à faire usage de leur propre raison et pour cela de leur fournir les connaissances scientifiques, philosophiques, littéraires, à partir desquelles ils pourront forger leur point de vue éthique et politique et participer à la délibération publique pour élaborer collectivement les lois sous lesquelles les citoyens acceptent de vivre. L’école n’a pas à promouvoir telle ou telle conception politique ou éthique, elle a à fournir aux élèves les armes intellectuelles de leur autonomie. C’est en ce sens que l’école est émancipatrice : en formant sans conformer.
Sociologie du curriculum et « réformes curriculaires »
La sociologie du curriculum (ou des curricula) est une approche en sociologie de l’éducation qui prend pour objet d’étude les contenus enseignés et les programmes d’étude. Les sociologues qui se consacrent à ce travail visent donc à produire des connaissances sur la définition des savoirs qui sont enseignés et sur l’organisation des apprentissages. On dispose de nombreuses présentations en français de ce courant initialement anglo-saxon : Bernstein (2007), Forquin (1989 et 2008), Deauvieau et Terrail (2002), Mangez (2008), Vitale (2006), Frandji et Vitale (2008), etc.
Aujourd’hui, dans les débats sur l’enseignement, un certain nombre de protagonistes défendent une « approche curriculaire » ou des « réformes curriculaires » qui consisteraient à mettre l’accent sur les compétences plutôt que sur les savoirs et sur l’étude de thèmes transversaux, plutôt que sur l’étude des disciplines. C’est de façon très abusive que les partisans de telles réformes se réclament de la sociologie des curricula.
Annexe 1
Éducation à… quoi ?
Éducation à l’altérité
Éducation à la santé
Éducation à la sécurité routière
Éducation à l’image
Éducation à la consommation
Éducation à l’environnement et au DD
Éducation à la sexualité
Éducation à la condition humaine (E. Morin)
Éducation à l’identité terrienne (E. Morin)
Éducation à la compréhension (E. Morin)
Éducation à l’orientation
Éducation à internet
Éducation à l’interculturalité
Éducation à la nutrition
Éducation à la responsabilité
Éducation à la culture informationnelle
Éducation aux nanotechnologies
Éducation à la non-violence et à la paix
Éducation à la défense
Éducation à la vie (université catholique de Lyon)
Éducation aux premiers secours
Éducation ménagère
Éducation à l’entrepreneuriat
Bibliographie
Albe V. (2010-2011), "Changements climatiques à l’école. Pour une éducation sociopolitique aux sciences et à l’environnement", Éducation relative à l’environnement, Vol. 9, 2019-2011.
http://www.revue-ere.uqam.ca/PDF/volume_9/V.ALBE.pdf
Albe V. (2012), "Des controverses socioscientifiques à l’école. Un enseignement de contenus scientifiques désocialisés ? Ou un relais d’enjeux sociopolitiques ?", Communication au colloque Sociologie et didactique organisé par la Haute École Pédagogique de Vaud en septembre 2012.
https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/uer-agirs/Actualit%C3%A9s/Colloque%20didactiques%20et%20sociologie/Contributions-du-colloque/atelier-2%E2%80%93demande-sociale-et-curriculum-r%C3%A9el/des-controverses-socioscientifiques-a-l-ecole-2012-uer-agirs-hep-vaud.pdf
Alpe Y. et Legardez A. (2011), "Le curriculum sournois de l’éducation au développement durable. L’exemple de l’usage de certains concepts économiques", Communication au colloque international francophone, Le développement durable : débats et controverses, 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
http://www.oeconomia.net/private/colloqueddiufm/30.colloquedd-alpe-legardez.pdf
Alpe Y. (2013), "Raretés, prix et valeurs : est-il possible de gérer « durablement » nos ressources ? Comment ? Qui doit décider ?", Journée de l’éducation au développement durable, Université d’Aix-Marseille, IUT de Dignes.
http://iut.univ-amu.fr/sites/iut.univ-amu.fr/files/conference_yves_alpe.pdf
Andler D. Fagot-Largeault A., Saint Sernin B. (2002), Philosophie des sciences (2 tomes), Gallimard, Coll. Folio.
Bader B., Barthes A., Legardez A., "Les rapports aux savoirs : une forme exploratoire des nouvelles postures éducatives", Éditorial, Éducation relative à l’environnement, Vol. 11, 2013.
http://www.revue-ere.uqam.ca/PDF/volume11/EDITO.pdf
Barberousse A., Kistler M., Ludwig P. (2011), La philosophie des sciences au XXe siècle, Flammarion, Coll. Champs.
Barthes A., Zwang A., Alpe N. (2013), "Sous la bannière développement durable, quels rapports aux savoirs scientifiques ?", Éducation relative à l’environnement, Vol. 11, 2013.
http://www.revue-ere.uqam.ca/PDF/volume11/11-4.pdf
Bautier E. et Goigoux R. (2004), "Difficultés d’apprentissage, processus de secondarisation et pratiques enseignantes : une hypothèse relationnelle", Revue française de pédagogie, n° 148, Juillet, août, septembre 2004
Bautier E. (2010), "Changements curriculaires : des exigences contradictoires qui construisent des inégalités. Entre littéracie, segmentation et contextualisation des savoirs", in Ben Ayed C. (dir.) (2010), L’école démocratique. Vers un renoncement politique ?, Armand Colin.
http://www.snes.edu/IMG/pdf/e_bautier_-_changements_curricul_.pdf
Beitone A. (2004), "Enseigner des questions socialement vives. Note sur quelques confusions", Communication à la 7ème Biennale de l’éducation et de la formation, 14-17 avril 2004.
http://www.eloge-des-ses.fr/pages/textes-en-ligne/qsvconfusions-ab-2004.pdf
Beitone (2011), "Sciences économiques et sociales et pédagogie invisible. Deux études de cas", Skholè, Livraison XIII, Octobre 2011
http://skhole.fr/sciences-%C3%A9conomiques-et-sociales-et-p%C3%A9dagogie-invisible-par-alain-beitone
Bernstein B. (2007), Pédagogie, contrôle symbolique et identité : théorie, recherche, critique, Presses de l’université de Laval.
Berthelot J.-M. (2008), L’emprise du vrai. Connaissance scientifique et modernité, PUF, Coll. Sociologie d’aujourd’hui.
Boghossian P. (2006/2009), La peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, Editions Agone.
Bougrain-Dubourg A. et Dulin A. (2013), L’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique, Rapport au CESE.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_28_education_environnement_developpement_durable.pdf
Bourdieu P. (1997), Méditations pascaliennes, Seuil (réédition, coll. Points).
Bourdieu P. (2001), Science de la science et réflexivité, Éditions Raisons d’agir.
Bourgeois Th. et Lecourt D. (2006), Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences, PUF, Coll. Quadrige, 4ème éd.
Bouveresse J. (2012), Les lumières des positivistes, Editions Agone.
Bréchon et Galland O. (dirs) (2010), L’individualisation des valeurs, Armand Colin, Coll. Sociétales.
Bürgenmeier B. (2004), Économie du développement durable, De Boeck
Cadet Mieze M. (2013), "L’étude du processus de représentation sociale du handicap dans notre société pour un apprentissage du « vivre ensemble »", Journée de l’éducation au développement durable, Université d’Aix-Marseille, IUT de Dignes.
http://iut.univ-amu.fr/sites/iut.univ-amu.fr/files/colloque_digne_cadet-mieze_0.pdf
Clément V., Le Clainche Ch., Serra D. (2008), Économie de la justice et de l’équité, Economica.
Condorcet (1791/1994), Cinq mémoires sur l’instruction publique, Garnier Flammarion (Présentation de Ch. Coutel et C. Kintzler).
Deauvieau J. et Terrail J.-P. (2002) (Dir.), Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs, La Dispute.
Diemer A. (2013), Une réponse aux défis posés par le développement durable, Éducation relative à l’environnement, Vol. 11, 2013 http://www.revue-ere.uqam.ca/PDF/volume11/11-13.pdf
Durkheim (1895), "L’enseignement philosophique et l’agrégation de philosophie", in Durkheim E. (1975), Textes, Volume 3, Éditions de Minuit.
Durkheim E. (1898), L’individualisme et les intellectuels, disponible sur le site Classiques des sciences sociales. http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/sc_soc_et_action/texte_3_10/individualisme.html
Durkheim E. (1898-1899), Lettre à Célestin Bouglé, in Durkheim E. (1975), Textes, Volume 2, Editions de Minuit.
Fink N. (2010), "Le débat, outil pour dépasser le sens commun ?", Les Cahiers Pédagogiques, n° 478, janvier. http://www.occe.coop/~ad14/ecocoop/cahiers_pedagogiques_478.pdf
FinK N. et Audigier F. (2011), "Grands principes et petits arrangements entre élèves : débats scolaires à propos du développement durable", Revue des Hautes Ecoles Pédagogiques, n° 13.
http://www.revuedeshep.ch/site-fpeq/Site_FPEQ/13_files/04_audigier.pdf
Fleurbaey M. (1996), Théorie économique de la justice, Economica.
Fleurbaey M. (2006), Capitalisme ou démocratie ?, Grasset.
Floro M. (2013), "Éducation au développement durable, un territoire révélateur", Éducation relative à l’environnement, Vol. 11, 2013.
http://www.revue-ere.uqam.ca/PDF/volume11/11-11.pdf
Forquin J.-C. (1989), École et culture. Le point de vue des sociologues britanniques, De Boeck.
Forquin J.-C. (2008), Sociologie du curriculum, Presses de l’Université de Rennes.
Fourez G. (2003), Apprivoiser l’épistémologie, De Boeck.
Frandji D. et Vitale Ph. (dir.) (2008), Actualité de Basil Bernstein, Presses de l’Université de Rennes.
Gamel C. (1992), Économie de la justice sociale, Cujas.
Granger G.G. (1995), La science et les sciences, PUF, Coll. QSJ.
Habermas J. (1998), L’intégration républicaine, Fayard (réédition, collection Pluriel, 2014).
Habermas J. (2001), Vérité et justification, Gallimard, Coll. Les Essais.
Habermas (2003), L’éthique de la discussion et la question de la vérité, Grasset, Coll. Nouveau collège de philosophie.
Haeberli Ph. (2009), "Participation à la vie scolaire et éducation à la citoyenneté : vers un nouveau paradigme ?", Communication au colloque international sur les didactiques de l’histoire, de la géographie et de l’éducation à la citoyenneté, Lausanne.
http://www.unige.ch/iufe/didactsciensoc/publications/2009/Haeberli.pdf
Kuhn Th. (1990), La tension essentielle : tradition et changement dans les sciences, Gallimard, Coll. Bibliothèque des sciences humaines.
Lange J.M. et Victor P. (2006), "Didactique curriculaire et « éducation à …la santé, l’environnement et au développement durable », quelles questions, quels repères ?", Didaskalia, n° 28, 2006.
http://www.stef.ens-cachan.fr/annur/lange/DIDASKALIA_06.pdf
Lange J.M. et Simonneaux J. (sd), La question des indicateurs du développement durable, regards croisés des didactiques.
http://www.stef.ens-cachan.fr/annur/lange/BioED%20JS_JML_08.pdf
Mayor F. (1999), Préface à E. Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740fo.pdf
Nadeau R. (1999), Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, PUF, Coll. Premier cycle.
Ogien R. (2013), La guerre aux pauvres commence à l’école. Sur la morale laïque, Grasset.
Orange Ravachol D. (2010), "Le rapport au « vrai » des enseignants en classe de sciences", Communication au Congrès de l’AREF 2010.
https://plone.unige.ch/aref2010/communications-orales/premiers-auteurs-en-o/Le%20rapport%20au%20vrai.pdf
Orange Ravachol D. (2013), "Les SVT entre sciences et « éducation à » : une mise à mal des principes qui structurent les savoirs ?", Communication au Congrès de l’AREF 2013.
http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/?q=book/export/html/1786
Pettit Ph. (2004), Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, Gallimard, Coll. Les Essais.
Piketty Th. (2008), Économie des inégalités, La Découverte, Coll. Repères.
Piketty Th. (2013), Le capital au XXIe siècle, Seuil.
Pinto L. (2014), "Le sociologue, la raison et l’histoire", in Tiercelin C. (2014), La reconstruction de la raison. Dialogues avec J. Bouveresse, Collège de France.
http://autourdejacquesbouveresse.blogspot.fr/
Rosat J.J. (2009), Annexe III "Sur Foucault et la vérité", in Paul Boghossian (2006/2009), La peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, Editions Agone.
Russel B. (1997), Essais philosophiques, PUF, Coll. L’interrogation philosophique
Sapiro G. (2004), "Défense et illustration de l’honnête homme. Les hommes de lettres contre la sociologie", Actes de la recherche en sciences sociales, n° 153 (pp. 11-27).
Sauvé L. (2000), "L’éducation relative à l’environnement entre modernité et postmodernité. Les propositions du développement durable et de l’avenir viable", In A. Jarnet, B. Jickling, L. Sauvé, A. Wals & P. Clarkin (dir.). The Future of Environmental Education in a Postmodern World ? Whitehorse : Yukon College, p. 57-70 (publié initialement en 1999 dans le Canadian Journal of Environnemental Education). http://www.institut-eco-pedagogie.be/spip/IMG/pdf_critiqueSauve_.pdf
Sen A. (2006), La démocratie des autres, Rivage poche.
Sen A. (2012a), L’idée de justice, Flammarion, Coll. Champs.
Sen A. (2012b), Repenser l’inégalité, Seuil, Coll. Points.
Simonneaux J., Lange J.-M., Girault Y., Victor P., Fortin-Denart C., Simonneaux L. (2006), "Multriréférentialité et rationalité dans les « éducations à »", Colloque Le développement durable sous le regard des sciences et de l’histoire. De la réflexion aux pratiques éducatives et de formation, Arras, 12 et 13 octobre 2006. http://www.yvesgirault.com/pages/jean-simonneaux.htm
Simonneaux J. (2006), L’enseignement de l’économie et l’éducation à la citoyenneté : quelle dialectique ?
http://oatao.univ-toulouse.fr/3697/1/Simonneaux_3697.pdf
Simonneaux J. (2007), "Les enjeux didactiques des dimensions économiques et politiques du développement durable", Écologie et politique, n° 34, 2007/1, Presses de Sciences Po.
http://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2007-1-page-129.htm#no4
Simonneaux J. (2011), "Quelles postures épistémologiques pour une éduction au développement durable ?", Communication au colloque Le développement durable : débats et controverses, 15 et 16 décembre 2011, Université Blais Pascal, Clermont Ferrand.
http://www.oeconomia.net/private/colloqueddiufm/39.colloquedd-simmoneaux.pdf
Simonneaux J. (sd), Durabilité, citoyenneté, environnement…des perspectives économiques communes. http://oatao.univ-toulouse.fr/3335/1/Simonneaux_3335.pdf
Sternhell Z. (2010), Les anti-lumières. Une tradition du XVIIIe siècle à la guerre froide, Gallimard, Coll. Folio.
Tutiaux-Guillon N. (2011), "La prise en compte des finalités de l’EDD en histoire et géographie en collège : prescriptions, posture des enseignants et manuels scolaires". Résumé d’une communication au Colloque international de l’histoire, de la géographie et de l’éducation à la citoyenneté, Lyon, 17 et 18 mars 2011.
http://ecehg.ens-lyon.fr/ECEHG/colloquehgec/2011-lyon/resumes-des-communications
Urgelli B. (2012), "Logique de communication et d’éducation dans l’enseignement de questions socioscientifiques", Communication au colloque Sociologie et didactique organisé par la Haute École Pédagogique de Vaud en septembre 2012.
https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/uer-agirs/Actualit%C3%A9s/Colloque%20didactiques%20et%20sociologie/Contributions-du-colloque/atelier-2%E2%80%93demande-sociale-et-curriculum-r%C3%A9el/les%20implications-d-une-interdisciplinarite-focalisee-sur-la%20didactique-des-questions-socioscientifiques-2012-uer-agirs-hep-vaud.pdf
Valente D. et Nigris E. (2013), "L’éducation à l’alimentation comme EEDD en Italie", Journée de l’éducation au développement durable, Université d’Aix-Marseille, IUT de Dignes.
http://iut.univ-amu.fr/sites/iut.univ-amu.fr/files/presentation_d._valente_digne_2013_0.pdf
Verdiani A. (2013), "Quelle transformation de l’école pour y développer l’EEDD ?", Intervention aux 3es assises de l’EEDD, Lyon-Villeurbanne, mars 2013.
http://www.assises-eedd.org/files/Pages/Fichiers/AN13-Actes-ForumTRTransfoEcole.pdf
Vergnole Mainar Ch. (2009), "Approches transdisciplinaires de l’éducation au développement durable dans l’enseignement secondaire", Revue M@ppemonde, n°94.
http://mappemonde.mgm.fr/num22/articles/art09205.html
Victor P. et Lange J.-M. (2012), "Un levier pour transformer l’école", Cahiers pédagogiques, Hors-série numérique n° 24, Janvier 2012.
Vitale Ph. (2006), La sociologie et son enseignement : curricula, théories et recherche, L’Harmattan.
Vivien F.-D. (2005), Le développement soutenable, La Découverte, Coll. Repères.
[1] A titre d’illustration, un séminaire organisé par plusieurs institutions à l’articulation de la recherche et de la formation professionnelle :
http://api.ning.com/files/WgzJ2AF1RZL11K1wof69ufpjFSGPZxEYDBPkvQKw9Hr1772i83E5u4itCCdOOyPZmwX4LeUXXfIWzI0Zel8mbaNv96qe2hGZ/seminairerichardetienne.pdf
Un colloque international est aussi organisé en novembre 2014 par l’ESPE de Rouen :
http://espe.univ-rouen.fr/les-educations-a.html
[2] A titre d’illustration voir cette vidéo sur le site du SNUIPP-FSU :
http://www.snuipp.fr/Joel-LEBEAUME-Les-sciences-et-la
[3] J’évoque ici surtout des exemples français ou européens, mais le thème a une indiscutable extension internationale. Par exemple, la plupart des systèmes scolaires africains ont fait l’objet de réformes fondées sur une « approche curriculaire » qui articule « approche par compétences » et « éducations à ».
[4] Voir en annexe une liste, certainement incomplète, des diverses « éducations à » que les professeurs sont invités à mettre en œuvre.
[5] Le lecteur familier des débats relatifs à l’enseignement des Sciences économiques et sociales en France reconnaîtra dans le discours sur les « éducations à » les invariants de ce que j’ai nommé la « doxa des SES » : relativisme épistémologique, accent mis sur la démarche inductive, refus de l’organisation disciplinaire des savoirs, contestation de la légitimité scientifique des savoirs enseignés au profit d’une légitimité « sociale », primat du débat, approche par les « objets » plutôt que par les savoirs, etc. En SES la doxa est justifiée par la prétendue spécificité des SES. En réalité, on le voit, la doxa des SES n’est rien d’autre que la déclinaison d’un discours général de remise en cause des savoirs que l’on trouve aussi à l’œuvre à propos des sciences de la nature (SVT notamment).
[6] Lucie Sauvé est une auteure très influente qui publie en anglais, français et espagnol. Elle est professeur à l’Université de Québec à Montréal. Elle a reçu, pour ses recherches en éducation à l’environnement des financements considérables (http://anea.org.mx/Pub_Lucie_Sauve.htm). Ses prises de position n’ont donc rien de marginal ou d’anecdotique.
[7] On notera au passage, même si ce n‘est pas notre objet ici, qu’il existe donc une démocratie moderne, connotée péjorativement car elle favorise la liberté de l’individu et de l’entreprise et une démocratie postmoderne…dont on ne nous dit rien !
[8] http://www.assises-eedd.org/files/Pages/Fichiers/AN13-Actes-ForumTRTransfoEcole.pdf
Au cours de ces assises sont intervenues, la Rectrice de l’académie de Lyon, la présidente du Conseil général du Rhône, la ministre de l’environnement de l’époque Delphine Batho.
[9] Comprenne qui pourra ! Depuis l’affaire Sokal, chacun connait le lien très fort entre la pensée post-moderne et le caractère très jargonnant des discours qui s’en réclament.
[10] Voir sur ce point le célèbre texte de Durkheim (1898) sur l’individualisme et les intellectuels et l’article essentiel de Gisèle Sapiro (2004).
[11] On peut citer notamment les travaux d’A. Giddens et d’U. Beck. Des analyses très importantes comme celles de J. Rawls, de P. Bourdieu, du marxisme analytique, de J. Habermas, de M. Gauchet, etc. s’inscrivent dans le paradigme de la modernité. Les enquêtes internationales montrent que les valeurs de la modernité structurent largement les prises de positions des enquêtés dans de nombreux domaines (en particulier pour tout ce qui concerne le libéralisme culturel). Voir sur ce point Bréchon et Galland (2010).
[12] Amartya Sen (2006) a fait une critique sans complaisance des discours qui considèrent que la démocratie est propre à l’Occident.
[13] Il est vrai cependant, que les tenants des « éducations à » n’hésitent pas à se débarrasser de façon cavalière des références les plus solides en matière d’épistémologie. V. Albe (2010-2011), par exemple, considère que les conceptions de Bachelard et de Popper donnent des signes d’obsolescence. Elle déplore d’ailleurs le fait que les professeurs de science qu’elle interroge se réfèrent « à un modèle particulier de scientificité des sciences de la nature, et à une approche à saveur bachelardienne et/ou poppérienne, où la science est vue comme une réponse à une question par recours à l’expérimentation et à la réfutation des hypothèses ». Si cela est obsolète, autant, en effet, supprimer l’enseignement des sciences !
[14] Évidemment, cet argument est sans portée pour les penseurs postmodernes des « éducations à ». Pour eux en effet tout se vaut (relativisme épistémologique). Bien mieux, ils s’opposent à la « science officielle » et refusent tout critère de légitimité des discours qui relèverait de la mise en œuvre des règles en vigueur dans le champ scientifique.
[15] Évidemment, il n’est pas illégitime de se référer à des manuels. Encore que, on pourrait attendre d’enseignants-chercheurs qui communiquent dans des colloques à prétention scientifique (qui plus est « internationaux »), qu’ils se réfèrent aux sources primaires. Mais le choix des manuels n’est évidemment pas neutre. Par exemple, dans la littérature consultée, il n’est jamais fait référence à l’excellent livre d’Alan Chalmers (1990). De même, des synthèses qui font autorité ne sont jamais évoquées : Barberousse, Kistler et Ludwig (2011), Andler, Fargot-Largeault, Saint-Sernin (2002), Nadeau (1999), Granger (1995), Bourgeois et Lecourt (2006).
[16] Il faut méconnaître totalement l’œuvre de Bourdieu, ou la travestir délibérément ,pour mobiliser cet auteur au service d’une remise en cause de la démarche scientifique : « C’est pourquoi, contre l’antiscientisme qui est dans l’air du temps et dont les nouveaux idéologues ont fait leurs choux gras, je défends la science et même la théorie lorsqu’elle a pour effet de procurer une meilleure compréhension du monde social », P. Bourdieu : Interview à Libération (3 et 4 novembre 1979), repris dans Questions de sociologie, Edition de Minuit, 1980.
[17] Quand ils vont au bout de leur logique, les partisans des « éducations à » proposent d’en finir avec Bachelard : « En considérant que les questions socioscientifiques mobilisent des connaissances complexes, incertaines, expertisés et médiatisées, des croyances et des considérations éthiques et politiques, tout regard didactique sur ces questions suppose nécessairement de dépasser l’approche bachelardienne » (Urgelli, 2012).
[18] Pour une critique de cette approche normative (pour ne pas dire moralisatrice) de l’enseignement, on peut consulter Ogien (2013).
[19] C’est ce que souligne aussi B. Urgelli (2012) : « Les enseignants sont alors placés dans une posture prescriptive puisqu’il est attendu d’eux qu’ils fassent partager aux jeunes générations des choix personnels et sociaux qui paraissent socialement désirables ».
[20] C’est aussi la position de J. Bouveresse et c’était la position de Bourdieu qui prônait la mise en œuvre d’une « pédagogie rationnelle » afin de déjouer la logique de la reproduction.
[21] Mais nos penseurs postmodernes considèrent sans doute que la clarté du langage est …positiviste donc obsolète !
[22] Par exemple, Ch. Vergnolle Mainar (2009) écrit, pour s’en réjouir que l’éducation au développement durable « est en rupture avec un cursus scolaire français centré, depuis la fin du XIXe siècle, sur l’acquisition de savoirs et de techniques enseignés par des disciplines scolaires constituées en structures indépendantes ».
[23] « L’enseignant devient un régulateur de débat au lieu d’être celui qui sait » (Floro, 2013).
[24] Les disciplines sont donc un danger et un obstacle à franchir. On peut noter que la dernière affirmation est fausse. En SES, le programme de terminale traite du développement durable dans un cadre disciplinaire et les enjeux politiques (choix des instruments de politique climatique par exemple) sont posés. Il n’y a donc pas nécessairement antinomie entre une approche disciplinaire et la prise en compte des enjeux politiques et sociaux.
[25] Assez curieusement, ils font aussi référence à Ivan Illitch, dont on ne peut pas dire qu’il soit un économiste !!!
[26] Ce qui caractérise ces trois auteurs, c’est qu’ils ont été des économistes … il y a très longtemps, mais qu’ils sont aujourd’hui essentiellement des militants politiques (Lipietz a même été brièvement candidat écologiste à la présidentielle). Ils publient dans la presse militante. Il semble bien que les partisans des « éducations à » qui veulent traiter de questions économiques, faute de lire la littérature scientifique, alimentent leurs propres publications par la lecture de publications militantes…ce qui les conduit tout naturellement à penser que décidément tout est idéologique !
[27] On peut en effet être néo-classique et pas libéral et être libéral et pas néo-classique.
[28] Ce livre est constamment réédité depuis 1997.
[29] Faut-il rappeler qu’Amartya Sen a obtenu le prix Nobel de science économique et pas le prix Nobel de citoyenneté ?
[30] Ajoutons que la théorie des jeux a très largement démontré la supériorité des stratégies coopératives sur les stratégies non coopératives. Prétendre dans ces conditions que la science économique ne s’intéresse pas à la coopération relève donc d’une méconnaissance de la science économique.
[31] Cet « enseignement systémique » est évidemment lié à l’approche de la complexité développée par E. Morin. On pourrait appliquer à ce thème de la complexité ce que Durkheim disait des « nuances » : « On dit qu’il y a là des choses trop fines, trop complexes pour que les grossiers procédés de la science puissent s’en emparer ; que le tout est en nuances, en qualités incatégorisables que le sentiment, l’intuition peuvent seuls apprécier. Ah ! Les nuances ! C’est le grand mot des hommes qui ne veulent pas penser » (Durkheim, 1898-1899, cité par Pinto 2014)
[32] Au demeurant, le dispositif pédagogique décrit ne prévoit de transmettre aux élèves les concepts permettant une telle analyse économique.
[33] En particulier les élèves, dont on nous rapporte les propos, contestent les analyses des experts du GIEC au motif qu’ils sont nommés par les gouvernements. Or, il est très important de faire comprendre aux élèves que le caractère vrai ou faux d’un énoncé scientifique, ne peut pas être tranché à partir du constat de l’intérêt qu’aurait le chercheur. Comme l’écrivait P. Bourdieu : « Et ce n’est pas parce qu’on pourrait découvrir que celui qui a découvert la vérité avait intérêt à le faire que cette découverte s’en trouverait tant soit peu diminuée » (Bourdieu, 1997, p. 11).
[34] Le caractère récurrent du refus de l’approche républicaine chez les partisans des « éducations à » ne manque pas de surprendre. En particulier, ils assimilent la posture républicaine au refus du débat et de la controverse. Cela relève de la méconnaissance totale de ce qu’est le républicanisme (voir Habermas, 1998 et Pettit, 2004). Pour des adeptes de l’éducation à la citoyenneté, cette méconnaissance est problématique.
[35] Je me permets de renvoyer à ma communication sur les « questions socialement vives » (Beitone, 2004).
[36] Bien sûr, les tenants des « éducations à » refusent la séparation entre faits et valeurs. Ils contestent toute forme d’autonomie à la question de la vérité scientifique par rapport aux choix éthiques, sociaux ou politiques. Sans doute sans en avoir conscience, ils se rallient au jdanovisme. La « science engagée » fait en effet furieusement penser à la « science prolétarienne » du stalinisme triomphant ou, dans un autre genre, à la « science chrétienne » de ceux qui considèrent que la science ne peut pas et ne doit pas être séparée de la foi.
[37] Les deux inspirateurs essentiels de cette approche, la sociologue Dominique Schnapper et le constitutionnaliste Dominique Rousseau, accordaient beaucoup d’importance à la dimension délibérative de la démocratie. Le contenu effectif de ce nouveau dispositif, ainsi que l’évolution des programmes sont deux questions qui mériteraient une étude approfondie.
[38] V. Albe (2012) offre un bel exemple d’utilisation contestable des références bibliographiques. Après avoir analysé des entretiens avec des enseignants de science de l’enseignement agricole qui se montrent attachés à leur discipline et à une épistémologie rationaliste, l’auteure déplore cette attitude de « résistance au changement ». Elle ajoute : « Ainsi la notion de code du savoir scolaire et l’opposition curriculum sériels/intégrés de Bernstein (1975) nous est apparue particulièrement fructueuse pour comprendre les points de vue d’enseignants de sciences relatifs à l’intégration scolaire de controverses socioscientifiques contemporaines en termes de leur sens de l’appartenance à une discipline et quant à leur perception des modifications en termes de répartition des pouvoirs entre enseignant et élèves et dans les relations pédagogiques et didactiques entre enseignants que pourraient induire l’enseignement de ces contenus nouveaux ». Ce sont les dernières lignes de l’article et on en saura jamais en quoi cette référence à Bernstein est utile. C’est particulièrement dommage parce que précisément, cette approche en termes « d’éducation à » est un bon exemple d’invisibilisation des savoirs, ce « code intégré » (qui suppose la mobilisation simultanée de savoirs très divers) est de nature à rendre plus difficiles les apprentissages des élèves les moins dotés en capital culturel et ceux qui ne peuvent pas compter sur un étayage extra-scolaire de leurs apprentissages. Délibérément ou pas, V. Albe cite donc Bernstein à contre-sens.
[39] Pour une présentation de l’importance des concepts de « genre premier » et « genre second » dans l’analyse des apprentissages scolaires, voir Bautier et Goigoux (2004). Pour une présentation des méfaits de la pédagogie invisible au sein d’une discipline scolaire, voir Beitone (2011).

