Accueil > École commune > Propositions du GRDS > Pour une école de l’exigence intellectuelle (présentation)
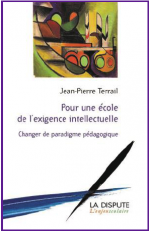 Pour une école de l’exigence intellectuelle (présentation)
Pour une école de l’exigence intellectuelle (présentation)
Un itinéraire de recherche
jeudi 18 février 2016, par
[L’ouvrage de Jean-Pierre Terrail : "Pour une école de l’exigence intellectuelle. Changer de paradigme pédagogique" vient de paraître à La Dispute (février 2016). À la suite de sa mise en discussion publique du 16 février avec la contribution de Marcel Gauchet, Bertrand Geay et Frédérique Rolet, nous publions ci-dessous une présentation par l’auteur de son parcours de recherche sur la question scolaire.]
Il m’a fallu plus de trois décennies d’investigations sociologiques touchant d’une façon ou d’une autre à la question scolaire pour en arriver à écrire ce petit livre. Évoquer le cheminement qui m’y a conduit me paraît une bonne façon de donner à voir la démarche de l’ouvrage.
La rencontre avec la question scolaire
C’est après quinze ans d’une carrière de chercheur qui démarre en 1968 que j’ai rencontré, de façon quelque peu inopinée, la question de l’école. Dans un contexte où les intellectuels progressistes étaient volontiers suspectés de mythifier le prolétariat, je m’étais décidé à entreprendre, en ce début des années 1980, une thèse d’État visant à rendre compte, sur le mode de l’investigation empirique, des transformations du monde ouvrier.
Sans liens familiers avec cet univers, je me mis en quête pour démarrer l’affaire d’informateurs instruits, et commençai à interviewer quelques collègues qui en étaient issus. Plutôt cependant que de répondre à ma curiosité et de me décrire le monde social dont ils avaient eu, enfants, une expérience intime, ces chercheurs se firent plutôt les témoins d’eux-mêmes et me livrèrent le récit de la réussite scolaire qui les avaient arrachés à leur milieu et aux destins d’usine. Je me résolus bientôt, face à la répétition de l’expérience, à changer mon fusil d’épaule. Puisque c’est leur histoire avec l’école que mes interlocuteurs ont en tête et qui les obsède, eh bien parlons-en.
L’entreprise n’était pas sans intérêt, puisqu’elle pouvait permettre d’identifier les conditions qui avaient rendu possible une entrée dans l’enseignement supérieur encore très minoritaire dans les familles populaires pour cette génération – une véritable aventure dont Annie Ernaux donnait dans ses romans, en ces mêmes années, sa version personnelle. Je poursuivis donc l’enquête en interrogeant une diversité d’intellectuels d’origine ouvrière sur leur parcours scolaire.
Sur le moment, cet épisode me parut très démonstratif de la façon parfois erratique et imprévisible dont se déroule un parcours de recherche, et de l’intérêt, comme le professent les interactionnistes, de se laisser « enseigner par le terrain ». J’y ai vu aussi, un peu plus tard, une manifestation de l’omniprésence souterraine de la question scolaire dans la vie sociale.
École et transformations ouvrières
Le détour ne fut pas du temps perdu. J’y découvris un aspect essentiel de la « modernisation » de la classe ouvrière en ces décennies. Ses membres s’étaient longtemps contentés d’une école qui assurait une alphabétisation minimum, couronnée dans le meilleur des cas par une formation professionnelle. Au cours des années 1960 ils se prennent de plus en plus souvent à envisager des études longues : c’est le cas, de rares sondages le montrent, de 15% d’entre eux en 1963, et de 60% en 1972. Impossible de ne pas mettre ce basculement rapide au compte de la réforme qui institue alors l’école unique, et ouvre à tous l’accès à l’enseignement secondaire. Impossible aussi de ne pas y voir l’effet d’une visée d’émancipation ancienne, que cette réforme crédibilise et libère : la désindustrialisation, le chômage de masse et l’exigence du diplôme pour assurer les reconversions intergénérationnelles ne sont alors en effet pas encore à l’ordre du jour. Ce fut une révolution silencieuse, ignorée sur le moment – y compris par les meilleurs chercheurs : c’est en 1974 que Pierre Bourdieu donne comme typiques des habitus populaires les attitudes d’auto-exclusion scolaire et de renoncement spontané aux études longues [1] – ; et qui reste largement méconnue aujourd’hui, comme l’attestent les imputations si fréquentes des échecs scolaires populaires au désintérêt et au manque d’investissement des familles.
De bonnes élèves
Ma thèse mit donc cette révolution en exergue, aux côtés de l’essor de l’emploi féminin et des pratiques de réduction de la fécondité, facteurs autant que manifestations de la modernisation ouvrière [2]. J’y interrogeais les conditions les plus favorables aux réussites ouvrières, sans aborder encore la persistance de masse de l’échec. L’écho qu’avait eu ce travail et la prise de conscience du rôle crucial de l’école dans les fonctionnements sociaux m’ont incité à rester particulièrement attentif, parmi d’autres sujets de recherche, aux investissements des familles dans la scolarité de leur descendants et aux parcours réussis.
Dans les premières années 1990, cet intérêt m’amena à m’affronter à cette sorte d’énigme sociologique que représentait la supériorité scolaire des filles. À l’encontre de ceux qui réduisaient le phénomène à l’effet d’un habitus de sexe (les filles seraient mieux préparées, par les vertus d’une éducation familiale cultivant le soin, l’attention, l’obéissance, à répondre aux réquisits de l’école), j’en observai le caractère historiquement spécifié (ce n’est que dans les années 1960 que les filles rattrapent les garçons, au moment donc où le marché du travail salarié s’ouvre pour elles), et différencié selon l’appartenance sociale (plus on descend l’échelle sociale, plus la différence sexuée des scolarités s’accroît). Je mis dans ces conditions l’accent, non sur l’efficace scolaire de « qualités féminines », mais sur l’hypothèse d’une mobilisation scolaire différentielle des filles, sachant que la qualité de leurs diplômes pouvait seule compenser leur désavantage relatif sur le marché du travail, tout en leur assurant, au plan des rapports conjugaux, une indépendance dont le défaut était fortement ressenti, jusque-là, par les femmes des milieux populaires [3].
Reprendre la question de l’échec scolaire
Au milieu des années 1990 cela faisait plus de dix ans que je m’intéressais aux processus de scolarisation et à leurs effets dans la société française, sans m’être risqué encore à interroger de plus près ce qui se jouait dans l’école elle-même. Celle-ci restait une boîte noire, pour moi comme pour une grande partie de la sociologie de l’éducation. L’ouvrage collectif paru en 1997 et dont j’avais pris l’initiative en témoigne à l’envi. Ambitionnant de faire le point des rapports école/société, un seul de ses douze chapitres aborde la question de la transmission des savoirs : encore est-il dû à deux chercheurs ne relevant pas expressément de la sociologie, et qui traitent du comportement des élèves bien plus que de celui des maîtres [4].
Pas d’indifférence aux différences
Cette publication allait pourtant m’inciter à entrer dans le vif du sujet. La tonalité du livre était globalement critique de la persistance des inégalités scolaires. Lors des débats publics suscités par sa parution, nombre d’enseignants me mirent au pied du mur. Ils pouvaient eux aussi déplorer la situation, mais pourrais-je leur dire comment précisément y mettre fin ?
Ainsi sommé de m’expliquer à mon tour avec la vieille question de l’échec scolaire, je décidai de m’y mettre sérieusement, en entreprenant, cela n’avait pas encore été fait, un bilan critique de la littérature considérable accumulée sur le sujet depuis quatre décennies. Je fis au plus large, en m’intéressant du même coup à l’histoire de l’institution scolaire, à son lien avec la culture écrite, aux difficultés inévitablement rencontrées par quiconque cherche à entrer dans cette culture et à s’en approprier les modalités ; et, au plan de l’investigation empirique, en procédant à la reconstitution des parcours d’élèves en échec, ainsi qu’à l’observation en classe, jusque-là peu pratiquée, de moments des apprentissages élémentaires, et enfin en m’attachant particulièrement aux modalités de l’apprentissage, crucial, de la lecture.
Cela me prit quelques années. J’en sortis en 2002, lesté de fortes convictions : du caractère non inéluctable de l’échec scolaire ; de la nécessité essentielle, pour le combattre, de regarder de près et de transformer les modalités des apprentissages cognitifs, plutôt que de noyer le poisson en incriminant la « multiplicité des facteurs déterminants » de l’échec, et en insistant sur le faible encadrement assuré par les familles populaires, sur leur rapport au savoir défaillant et sur la propension de leurs enfants à se contenter d’accomplir au mieux leur « métier d’élève » ; de l’exigence, enfin, de revenir sur la thèse bourdieusienne d’une « indifférence [de l’école] aux différences [entre ses publics] ». Ce dernier point m’apparaissait crucial, la supposée indifférence de l’école étant contredite non seulement par le poids des effets d’étiquetage défavorables aux milieux populaires dans l’évaluation des élèves et la gestion de leur parcours mais aussi, et peut-être surtout, du fait des différenciations spontanément introduites par les enseignants dans la conduite des apprentissages selon les classes et les publics [5].
La perspective d’une école « commune »
Cette propension des enseignants à minorer leurs ambitions pédagogiques à l’endroit des publics populaires s’inscrit dans une logique du « donner moins à ceux qui ont moins » qui ordonne l’ensemble de notre système éducatif. Cette logique discriminatoire, proprement institutionnalisée, ne laisse aucune chance à « l’égalité des chances ». Son exercice est rendu possible par la mise en concurrence des élèves, telle que l’organise le dispositif de leur évaluation, de leur classement hiérarchique, et de leur orientation. Je réalisai très vite, dans ces conditions, que toute lutte véritable contre l’échec scolaire et pour la généralisation des études longues passait par l’éradication de cette logique et de son fondement, la mise en concurrence des élèves. Longtemps considérée comme le moyen de réaliser « l’égalité des chances », l’école unique mise en place dans les débuts de la Cinquième République m’apparaissait désormais elle-même comme un obstacle décisif à une véritable démocratisation de l’école, que seule une « école commune », articulée autour d’une scolarité sans classement des élèves et, jusqu’à la fin du secondaire, sans voies de dérivation, pouvait permettre de réaliser [6].
L’alternative de l’école commune
Sans abandonner la réflexion critique sur l’existant, il m’importait désormais d’explorer plus avant l’alternative de l’école commune, et d’en mesurer la crédibilité. Deux grandes questions s’imposaient à mon programme de travail. Afin de m’assurer du réalisme de la perspective d’un enseignement qui soit à la fois de masse et d’ambition, il me fallait reprendre, d’une part, la thématique du « tous capables », en approfondissant l’examen critique de la thèse du handicap socioculturel. Et interroger, d’autre part, les modalités possibles d’une conduite des apprentissages susceptible de permettre à tous les élèves d’entrer normalement dans la culture écrite : supprimer la concurrence entre les élèves, et donc les notes, le redoublement et les filières dévalorisées, ne dit en effet rien encore de la façon dont on peut aider les élèves à surmonter leurs difficultés cognitives.
Tous capables ?
La question de l’éducabilité de tous m’invitait, paradoxe pour un sociologue, à abandonner le terrain de la diversité des cultures, des différences de classe, de genre et de génération, pour m’intéresser à l’universel, au bagage commun des jeunes humains. La thèse du handicap socioculturel a le bon sens des apparences : si les uns réussissent à l’école et pas les autres, dit-elle, c’est qu’il manque à ces derniers l’héritage culturel dont disposent les autres. Mais la bonne question n’est pas celle de la différence culturelle, c’est celle que pose toute entreprise de démocratisation scolaire, que l’on peut formuler ainsi : ceux qui sont, de par leurs appartenances socioculturelles, les moins bien préparés à satisfaire aux réquisits de l’école, ont-ils néanmoins des ressources suffisantes pour surmonter les difficultés d’apprentissages bien conduits ?
Plutôt que de gloser à mon tour sur ce qui manque à ces élèves, je me suis donc posé la question de ce dont ils disposent. Et, en matière de ressources intellectuelles, ce qui rapproche tous les humains, quelles que soient leurs différences ethniques et culturelles, c’est le fait du langage, c’est la maîtrise d’une langue quelconque, suffisante à 6 ans pour satisfaire les besoins de la vie quotidienne et toujours susceptible de s’enrichir indéfiniment. Or, comme l’attestent aussi bien la théorie linguistique moderne que les investigations des ethnosciences, l’acquisition de cette maîtrise s’accompagne inéluctablement de la formation d’un potentiel de maniement de l’abstraction, de raisonnement logique, de pensée réfléchie. Cet outillage intellectuel est disponible et suffisant pour une entrée normale dans la culture écrite, et tout le problème d’une bonne conduite des apprentissages est de parvenir à le mobiliser pleinement [7].
Comment enseigner ?
Concernant précisément, par ailleurs, la conduite des apprentissages, je poursuivis deux objectifs : contribuer au réexamen de la pédagogie de la lecture, dont la si faible efficacité actuelle grève lourdement tout espoir de réduction des inégalités scolaires ; et mieux comprendre pourquoi, plus largement, le grand réaménagement pédagogique des années 1970-80, marqué par le passage du principe du transmettre au principe de l’apprendre, et lesté d’intentions généreuses, avait produit si peu de résultats.
En matière de lecture j’avais pris parti, dès 2002, et à contre-courant de l’opinion pédagogique progressiste, on ne manqua pas de me le faire savoir, pour la méthode syllabique, dont la critique et le rejet répulsif furent au cœur de la rénovation des méthodes d’enseignement au tournant des années 1960/70, et restaient très vifs. L’enjeu était trop important pour que je l’abandonne, et je m’efforçai, en collaboration avec Geneviève Krick et Janine Reichstadt, d’explorer la question sous toutes ses dimensions. Nous voulûmes soumettre nos convictions à l’épreuve de la pratique en produisant notre propre manuel, dont l’efficacité fut reconnue par l’enquête que dirigea Jérôme Deauvieau en 2013 [8] .
Au-delà de l’apprentissage de la lecture, il me fallait remonter à l’esprit de la réforme pédagogique, appréhender ses effets pratiques, en comprendre les limites, réfléchir à la façon de les dépasser. L’entreprise put bénéficier de deux points d’appuis. D’une part la création en 2008 du GRDS (Groupe de recherches sur la démocratisation scolaire) fournit un cadre de travail particulièrement stimulant. Rassemblant des chercheurs entre lesquels des collaborations s’étaient nouées dans les années précédentes [9] et des enseignants militants syndicalistes en quête d’un milieu propice aux investigations de recherche et à la distanciation réflexive, ce milieu de travail s’avéra dynamique et productif, ses membres partageant le souci d’une véritable démocratisation de notre système éducatif et le désir d’approfondir la perspective d’une école « commune » assez radicalement novatrice [10]. D’autre part, à partir de la deuxième moitié des années 2000, les recherches menées dans les classes mêmes et concernant la conception des apprentissages et les pratiques des maîtres connurent un essor relatif, aboutissant à des relevés d’observation riches d’enseignements quant à la logique des dispositifs pédagogiques dominants et aux conditions de leur manque d’efficacité [11].
Le GRDS s’est d’abord attaché à mettre en évidence l’exigence conjointe de nouvelles pratiques d’enseignement et d’une profonde évolution de la formation et du recrutement des enseignants. Depuis 2012 le collectif s’est engagé dans une réflexion d’ensemble sur ce que pourraient être les contenus d’enseignement d’une école commune. J’ai continué à travailler parallèlement pour ma part sur la conduite des apprentissages, à laquelle Pour une école de l’exigence intellectuelle est consacré.
Une école démocratique ne peut être qu’une école exigeante pour tous ses publics
Ce qui a déclenché le projet de l’ouvrage est certainement la prise de conscience du caractère foncièrement déficitariste de ce que Marcel Gauchet appellerait la révolution de l’apprendre.
Une rénovation sous hégémonie du principe déficitariste
Sans doute la rénovation pédagogique des années 1970-80 procède-t-elle de la reconnaissance du caractère nécessairement actif des apprentissages et du souci de traiter l’enfant comme une personne, d’être attentif à son développement et à son épanouissement, de l’instruire par le jeu et en mobilisant sa curiosité plutôt que par l’inculcation et l’autorité. C’en sont là les valeurs rectrices mises en avant dès les années 1970 par Basil Bernstein en Angleterre et Jean-Claude Chamboredon en France, qui en attribuent la paternité aux salariés instruits des nouvelles classes moyennes souhaitant leur mise en œuvre pour leurs propres enfants. Je n’ai jamais vu de raison de revenir sur leur analyse, et leur pronostic selon lequel ces valeurs devaient conduire à la mise en œuvre d’une pédagogie « invisible » peu propice à la réussite des enfants des classes populaires m’a toujours paru parfaitement validé par l’expérience historique.
Je savais certes que l’on ne pouvait en rester à la thèse d’une mise à jour de l’institution scolaire face à la transformation des représentations de l’enfance et des pratiques éducatives. Les travaux des historiens français, d’une part, ont souligné le rôle que le sentiment de l’inadaptation d’une partie des nouveaux publics accédant alors au secondaire avait pu jouer dans l’introduction de nouvelles procédures de conduite des apprentissages élémentaires, qui firent l’objet de différentes expérimentations dès les années 1960. Et les travaux de la sociologie de l’éducation, comme mes propres investigations de recherche, m’avaient convaincu de la propension majoritaire chez les enseignants à modérer leurs ambitions pédagogiques dès qu’ils avaient à faire à des publics populaires.
J’avais mal mesuré cependant ce qui m’est apparu très clairement dès lors que je suis revenu plus précisément sur le tournant des années 1960/70, à l’examen de textes des acteurs majeurs de l’époque ou des observations d’historiens, telles celles d’Antoine Prost. Il s’avère en effet que le présupposé de l’insuffisance des ressources mentales, intellectuelles et culturelles des élèves des classes populaires face aux exigences d’une entrée normale dans la culture écrite n’est pas seulement le fait des enseignants, ou d’une majorité d’entre eux : il est au cœur même de la rénovation pédagogique, au principe de son motif, de sa conception, jusqu’aux modalités pratiques de sa mise en œuvre. En ce sens il me paraît légitime de parler de paradigme « déficitariste » s’agissant de qualifier l’horizon de pensée de la rénovation pédagogique.
Celle-ci représente bien une mise à jour de l’école, impulsée par le nouveau salariat instruit, pour reprendre les analyses de Bernstein et Chamboredon, une forme d’adaptation de notre système éducatif face aux transformations historiques des représentations de l’enfant et des pratiques éducatives des familles. Mais il importe de souligner combien la mutation s’effectue, de part en part, sous l’égide du principe déficitariste.
La rénovation pédagogique met en place un ensemble très cohérent, qui va de ce fait s’avérer doté d’une grande stabilité. Les formes institutionnalisées de conduite des apprentissages empruntent, tout autant que les dispositions spontanées des enseignants, aux valeurs d’émancipation des classes moyennes ; les unes comme les autres sont par ailleurs également marquées au sceau du rapport des classes moyennes aux classes populaires, dont les membres leur apparaissent, dans la compétition pour les places scolaires, dotées d’une infériorité cognitive naturelle. Ainsi sans doute peut-on comprendre l’étonnante capacité de résistance qu’oppose ce dispositif historique aux démentis de l’expérience, qui témoigne pourtant à l’envi de la faible efficacité des modes de conduite des apprentissages instaurés alors et dont le principe est toujours à l’œuvre aujourd’hui.
Changer de paradigme
Les observations de terrain les plus diverses convergent à cet égard : les pratiques d’enseignement inspirées par le principe déficitariste sont contre-productives.
Si l’on admet, ce que je me suis efforcé d’argumenter de près par ailleurs, que le préjugé déficitariste laisse dans l’ombre la réalité des capacités intellectuelles des élèves issus des classes populaires, une réelle volonté de démocratiser l’école inviterait à en finir avec le leitmotiv des réformateurs des années 1960-70, pour lesquels il fallait avant tout éviter de mettre ces élèves en difficulté ; et à lui substituer le principe d’une forte exigence intellectuelle à leur égard, seul moyen de leur apporter les ressources que les autres puisent dans leur milieu familial.
Il me restait, une fois mise en évidence la nécessité de cette mutation au bénéfice d’un paradigme de l’exigence, à explorer les conditions de sa mise en œuvre, qu’il s’agisse :
* de la façon de conduire les apprentissages et de la reconfiguration des dispositifs pédagogiques : quelles conséquences tirer de la thèse selon laquelle il faut mobiliser les ressources intellectuelles des élèves des classes populaires plutôt que de s’adapter à leurs manques ? Le paradigme de l’exigence impose-t-il le retour à un enseignement purement magistral, ou peut-il laisser une place à la posture constructiviste, qui valorise le cheminement autonome de l’élève ? Comment repenser la question de la « motivation » des élèves ? Quel parti peut-on tirer de l’expérience de l’éducation nouvelle et des pédagogies alternatives ?
* de l’accueil possible des nouveaux principes pédagogiques par les jeunes générations. On sait l’ampleur des comportements de rejet des savoirs et de l’école, notamment au collège. Une pédagogie de l’exigence ne risque-t-elle pas d’aggraver le problème ? Comment repenser la question de l’autorité magistrale susceptible d’emporter l’adhésion des élèves ? Et quelle peut être la place d’une école de l’ambition intellectuelle à l’heure de la révolution des technologies de l’information et de la communication, sachant le temps que les jeunes passent devant leurs écrans ?
* de l’indispensable mobilisation des enseignants et des mutations conjointes dans leur culture professionnelle. En ce domaine aussi la mise en place d’un tronc commun et l’éradication de la concurrence entre les élèves s’avèrent essentielles. Elles modifient en effet la mission confiée à ses personnels par l’institution scolaire et transforment leurs conditions de travail, les invitant à traiter la difficulté d’apprentissage par des moyens exclusivement intellectuels et pédagogiques, en abandonnant tout recours aux moyens d’ordre institutionnel en usage aujourd’hui (la mauvaise note, le redoublement, etc.).
J’ai le sentiment d’avoir abordé ces questions avec prudence, mais avec aussi la conviction que mettre en débat les conditions essentielles d’une véritable démocratisation scolaire relève aujourd’hui de l’urgence sociale.
Table des matières de l’ouvrage
Introduction
Chapitre 1 - Une pédagogie de l’adaptation au manque
Une réforme pour les enfants du peuple
S’adapter aux élèves des milieux populaires
À l’entrée dans la culture écrite, deux réformes : mathématiques et lecture
Des principes pédagogiques aux dispositifs d’enseignement
Un détour pédagogique envahissant
Comment faire face aux publics hétérogènes ?
Chapitre 2 – La pédagogie rénovée, crise et emprise
Un horizon indépassable ?
Le double jeu de la rénovation pédagogique
L’adhésion du monde éducatif
Les conditions du renouveau
Chapitre 3 – Justification du paradigme de l’exigence
Les trompe l’œil
L’« égalité des intelligences », de la formule au constat
Du paradigme du déficit au paradigme de l’exigence
L’ambition des fins et le souci des moyens
À propos des jeunes générations
Chapitre 4 – Sur la mise en œuvre du nouveau paradigme
Repères d’une pédagogie de la réussite pour tous
La reconfiguration des dispositifs pédagogiques
Pédagogie de l’exigence et gestion de la classe
Enseigner sans mettre en concurrence
Conclusion
[1] Pierre Bourdieu, « Destins de classe et causalité du probable », Revue française de sociologie, vol. XVI, 1974.
[2] Voir Destins ouvriers. La fin d’une classe ?, PUF, Paris, 1990.
[3] Voir : « La supériorité scolaire des filles : une énigme sociologique », in Jean-Pierre Terrail, La Dynamique des générations, L’Harmattan, Paris, 1995.
[4] Il s’agit du chapitre 6 : « Apprendre : des malentendus qui font la différence », par Élisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex, voir Jean-Pierre Terrail (direction), La Scolarisation de la France. Critique de l’état des lieux, La Dispute, Paris, 1997.
[5] Voir Jean-Pierre Terrail, De l’inégalité scolaire, La Dispute, Paris, 2002.
[6] Voir Jean-Pierre Terrail, École, l’enjeu démocratique, La Dispute, Paris, 2004.
[7] Voir Jean-Pierre Terrail, De l’oralité. Essai sur l’égalité des intelligences, La Dispute, Paris, 2009 ; et Entrer dans l’écrit. Tous capables ?, La Dispute, Paris, 2013.
[8] Voir : Jean-Pierre Terrail, De l’inégalité scolaire, 2002, ouvrage cité, chapitre XIV ; Geneviève Krick, Janine Reichstadt, Jean-Pierre Terrail, Apprendre à lire. La querelle des méthodes, Gallimard, Paris, 2007 ; Janine Reichstadt, Jean-Pierre Terrail, Geneviève Krick, Je lis, j’écris. Un apprentissage culturel et moderne de la lecture-CP, Les Lettres bleues, Paris, 2009 ; Janine Reichstadt, Apprendre à lire : l’enjeu de la syllabique, L’Harmattan, Paris, 2011 ; Jérôme Deauvieau, Janine Reichstadt, Jean-Pierre Terrail, Enseigner efficacement la lecture, Odile Jacob, Paris, 2014.
[9] C’est le cas notamment de Jérôme Deauvieau (voir Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs, La Dispute, Paris, 2007 (en collaboration avec Jean-Pierre Terrail), et Enseigner dans le secondaire, La Dispute, Paris, 2009), comme de Tristan Poullaouec (Le Diplôme, arme des faibles, La Dispute, Paris, 2010).
[10] La publication en 2012 d’un ouvrage collectif, auquel ont contribué Alain Becker, Jérôme Deauvieau, Tristan Poullaouec, Janine Reichstadt, Jean-Pierre Terrail et José Tovar, marque une étape importante du travail entrepris, voir GRDS, L’école commune. Propositions pour une refondation du système éducatif, La Dispute, Paris, 2012. Par ailleurs le site www.democratisation-scolaire.fr donne à lire la production des membres du GRDS et des collaborations qu’il s’est assurées au fil des ans.
[11] C’est le fait notamment de chercheurs d’ESCOL (qui avaient longtemps réservé leurs investigations, pour l’essentiel, au seul comportement des élèves) : voir Élisabeth Bautier (dir.), Apprendre à l’école, apprendre l’école, Chroniques sociales, Lyon, 2006 ; Stéphane Bonnéry, Comprendre l’échec scolaire, La Dispute, Paris, 2007 ; Élisabeth Bautier et Patrick Rayou, Une réflexion sur le processus d’apprentissage et ses difficultés, PUF, Paris, 2009 ; Christophe Joigneaux, Des processus de différenciation dès l’école maternelle, thèse de doctorat, Paris VIII, 2009) ; ainsi que de laboratoires participant au réseau Réséda : voir Jean-Yves Rochex et Jacques Crinon (dir.), La construction des inégalités scolaires, PUR, Rennes, 2011. On rappellera également les observations réalisées dans le cadre du laboratoire Printemps-UVSQ (Jean-Pierre Terrail, De l’inégalité scolaire, ouvrage cité, 2002 ; Jérôme Deauvieau, Enseigner dans le secondaire, La Dispute, Paris, 2009) ; ou à l’EHESS, (Houssen Zakaria, Que font les maîtres ? Pour un bilan de la rénovation pédagogique à l’école, La Dispute, Paris, 2012).

