Accueil > Controverses pédagogiques > Penser avec les mots, dans toutes les disciplines
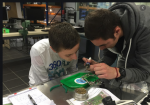 Penser avec les mots, dans toutes les disciplines
Penser avec les mots, dans toutes les disciplines
samedi 18 avril 2020, par
[Janine Reichstadt rebondit ici sur deux ouvrages importants que viennent de publier les éditions La Dispute : celui d’Anne-Sophie Romainville, "Les faces cachées de la langue scolaire" (2019) ; et "Pédagogies de l’exigence" (2020), ouvrage collectif rassemblant des témoignages d’enseignants qui, à tous les niveaux de la scolarité, exercent face à des publics « difficiles », et refusent pour autant d’en rabattre sur l’ambition intellectuelle qu’ils nourrissent pour leurs élèves. Ces publications l’ont ramenée à un texte de 1996 dans lequel elle réfléchissait sa propre expérience de professeur de philosophie confrontée à des élèves de terminale technologique, texte dont elle commente ci-dessous deux extraits. Les circonstances qu’elle évoque illustrent notamment une thèse centrale de la recherche d’Anne-Sophie Romainville : quelle que soit la discipline considérée, la valeur scolaire des élèves est largement redevable à leur capacité « métadiscursive », à leur capacité d’approche réfléchie des textes écrits si l’on préfère. Cette règle se vérifie, constate Janine Reichstadt, jusque dans les matières technologiques, là même où la chose est la moins attendue, au premier chef par les élèves eux-mêmes. Voilà qui vient souligner l’absurdité de la politique actuelle qui liquide les « enseignements généraux » dans les filières professionnelles : et plus largement qui confirme la pertinence d’une perspective de tronc commun jusqu’à la fin du secondaire. Voilà qui suggère que, quelle que soit la spécialisation professionnelle ultérieure et le type de qualification recherché, les jeunes générations ont besoin d’une culture commune de haut niveau, propre à leur assurer une sérieuse maîtrise de la langue écrite.]
La publication à La Dispute de l’ouvrage collectif Pédagogies de l’exigence. Récits de pratiques enseignantes en milieux populaires (disponible en librairie le 21 mai 2020), m’a rappelé un texte rédigé à l’intention de mes collègues du lycée Le Corbusier à Aubervilliers fin 1996. La vie syndicale était importante dans ce lycée : nous étions engagés dans une action pour obtenir les moyens nécessaires pouvant nous permettre de mieux travailler avec les élèves de ce lycée polyvalent au recrutement populaire. J’y étais impliquée, mais dans le même temps, il me paraissait évident que revendiquer des moyens ne pouvait pas suffire. Autrement dit, la réflexion de nos pratiques enseignantes, déjà amorcée avec plusieurs collègues, devait se développer. C’est pourquoi j’ai proposé à la réflexion collective un texte dans lequel je rapportais ce qui s’était passé dans deux classes de séries technologiques (génie mécanique et génie électrique), et qui me paraissait introduire une question sensible. Dans une classe il s’agissait d’un travail commun avec le professeur de génie mécanique, que les élèves ont appelé cours de « méca-philo », dans l’autre le travail portait sur l’étude d’un texte philosophique.
Ici, je reprends des extraits de ce texte tel qu’écrit à l’époque. Intitulé "De la nécessaire présence aux mots", il a fait l’objet d’une publication dans Pratiques de la philosophie n°5 (1997), revue du secteur Philosophie du GFEN, et dans Société française n°10 (60) (1998). Aujourd’hui j’accompagne ces extraits de commentaires qui doivent beaucoup à l’ouvrage particulièrement instructif sur ces questions d’Anne-Sophie Romainville, Les faces cachées de la langue scolaire. Transmission de la culture écrite et inégalités sociales (La Dispute, 2019).
Premier extrait du texte de 1996 : en "méca-philo"
" - Mais comment fais-tu pour faire de la philo avec ces élèves ?
- Et toi, comment fais-tu pour faire de la méca ?
Dans cette réponse je ne cherchais ni la boutade, ni la fin de non-recevoir destinée à mettre dos-à-dos les problèmes que nous rencontrons dans nos enseignements respectifs. Au contraire, elle m’est venue en pensant au fait qu’assez rares sont les élèves dont les résultats scolaires se trouvent écartelés entre l’excellence et la « nullité ». Leur réussite ou leur échec tend plutôt vers une certaine homogénéité dans les différentes disciplines. Sans chercher à faire passer au second plan les spécificités de chacune d’elles et les pratiques d’enseignements qu’elles nous conduisent à réfléchir, je pense que nous sommes tous confrontés à un problème de nature sensiblement identique : un certain rapport à l’articulation entre les mots et la pensée chez les élèves en difficulté notamment, qui rend très délicat leur entrée savante dans le sens des contenus et des multiples textes lus et écrits par eux. (…)
En philosophie la moindre absence au « moindre » mot ou temps de verbe peut-être fatale au sens d’un texte lu et écrit. Mais j’ai souvent entendu les professeurs d’autres disciplines dire de travaux ayant échoué à produire une pensée juste, précise, rigoureuse, qu’ils relèvent d’une lecture dilettante, inattentive aux textes quels qu’ils soient, et d’une écriture où les élèves concernés ne semblent pas avoir cherché à écrire autre chose que « n’importe quoi ». Ces élèves donnent effectivement l’impression de « picorer » dans les phrases qu’ils lisent et donc de se laisser aller à glisser sur leur sens, lequel se construit dans tous les mots concourant à définir une pensée déterminée. Que leur écriture s’en ressente n’a rien d’étonnant : souvent bâclés, extrêmement lapidaires (deux ou trois mots peuvent être « jugés » suffisants pour « penser » une argumentation ou une démonstration), leurs textes peuvent devenir d’étranges compositions où le sens est mis à mal. Leur impossibilité de relire leurs travaux me paraît d’ailleurs symptomatique de ce qu’ils peuvent vivre alors : ils pressentent sans doute bien que ce ne sont pas quelques corrections de « détail » qui pourraient améliorer sensiblement leur copie. (…)
Je pense que les élèves en difficulté dans un lycée comme le nôtre qui comporte un secteur technologique important, sont victimes d’une illusion dans laquelle ils ont tendance à « camper », et qui consiste à dissocier les contenus disciplinaires de la langue. « Quand on fait de la physique ou de la productique, on ne fait pas du français : on n’est pas là pour ça. » Cette illusion se rencontre dans toutes les classes, mais elle me paraît particulièrement présente dans celles des séries technologiques et notamment les séries STI [1]. Orientés vers ces filières parce qu’ils ne réussissaient pas dans les matières d’enseignement général où le français occupe une place de choix, on peut comprendre qu’ils aient envie de « passer à autre chose », afin d’oublier ce qui pour eux a été source de bien des déboires. Seulement ce n’est pas possible. La culture scientifique et technique se fonde sur des exigences conceptuelles qui ne peuvent être pensées que dans la langue, car la pensée ne commence pas par se constituer pour ensuite aller chercher les mots qui puissent la dire, et les mots quant à eux ne sont pas une sorte de réserve dans laquelle la pensée viendrait puiser les moyens de son expression, après coup. C’est dans un même mouvement que les mots et la pensée s’articulent. (…)
J’ai proposé à Michel Chesne, professeur de génie mécanique, de faire ensemble, avec les élèves de Terminale Gm [2], un travail de lecture et d’écriture dans sa discipline. Il a choisi un bac blanc que les élèves venaient de faire. Le problème qu’ils avaient à traiter comportait de nombreuses questions en relation avec un volumineux dossier technique dont ils disposaient ; mais compte tenu du temps que nous nous étions imparti, nous n’avons travaillé que la première question formulée ainsi : « Indiquer en quelques phrases concises comment est réalisée la liaison complète entre la douille moteur 9 et la broche 20. »
Les réponses des élèves étaient toutes lapidaires, imprécises et ne respectaient pas la demande de faire des phrases. Nous avons commencé par les lire avec eux au rétroprojecteur pour qu’ils voient bien le matériau à partir duquel la réflexion allait pouvoir s’engager, puis je suis intervenue pour parler de la lecture que je pouvais faire de la question en faisant les remarques suivantes.
On nous demande d’indiquer quelque chose mais pas n’importe comment. Il va falloir le faire avec des phrases, concises certes, mais le pluriel ne fait aucun doute. En philosophie, nous savons bien qu’une affirmation n’a aucune valeur tant que les raisons pour lesquelles elle se veut juste ne sont pas examinées, ce qui implique que nous ne pouvons pas le faire en quelques mots rapidement énoncés. Bien que les objets soient très différents, pouvons-nous, en construction mécanique, nous contenter d’une simple courte phrase incapable d’expliciter quoi que ce soit ? Ici, le lecteur doit comprendre « comment est réalisé la liaison complète ». Écrire comme le fait un élève que « la liaison entre 9 et 20 est un encastrement » ne peut pas suffire, car même si c’est juste, les quelques mots de la réponse se contentent de nommer cette liaison : elle n’explicite pas la façon dont elle est réalisée, et donc ne rend pas compte de l’essentiel du montage dont il est question. Faire cela passe par de multiples mots qui ont besoin de phrases pour organiser, préciser la pensée.
Autre remarque que j’ai pu faire : l’énoncé parle d’une liaison complète. Je ne sais pas ce que c’est dans ce domaine de la construction mécanique, mais je peux quand même me dire que l’adjectif risque bien de n’être pas là par hasard. N’y aurait-il pas des liaisons incomplètes ? Si oui, il doit y avoir de sérieuses différences entre les deux catégories qu’il faut sans doute avoir en tête au moment de la réponse, afin de bien marquer ce qui spécifie la liaison qui, elle, est complète. Après que les élèves aient répondu positivement à ma question, je leur ai dit que je ne pouvais plus continuer. Je pouvais bien voir sur le plan du dossier technique que la numérotation en 9 et 20 pointait des pièces ; mais ma méconnaissance de ce qu’est une douille moteur et une broche, ici, m’interdisait de les identifier réellement, de comprendre le sens du schéma, et de pouvoir poursuivre une lecture compréhensive de l’énoncé.
Michel Chesne a alors repris le problème avec les élèves, en travaillant avec ce qu’ils disaient sans leur soumettre un corrigé type. Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à intervenir, schéma explicatif à l’appui, au tableau. Nous leur avons ensuite demandé de rédiger de nouveau la réponse, soit individuellement, soit par groupe de deux ou trois. Même un lecteur profane en construction mécanique comme je le suis peut apercevoir la différence. Voici deux réponses représentatives du bac blanc, en plus de celle que j’ai citée :![]() La liaison complète entre la douille moteur 9 et la broche 20 est réalisée à l’aide d’une goupille élastique.
La liaison complète entre la douille moteur 9 et la broche 20 est réalisée à l’aide d’une goupille élastique.![]() La liaison 9/20 est un encastrement grâce à la goupille élastique 46.
La liaison 9/20 est un encastrement grâce à la goupille élastique 46.
Voici maintenant deux exemples de nouvelles réponses :![]() La liaison complète est une liaison encastrement, c’est-à-dire que la liaison entre la douille moteur 9 et la broche 20 est effectuée par un centrage long entre ces deux pièces. Pour cela on installe la goupille 46 afin d’éliminer tout mouvement de rotation et de translation.
La liaison complète est une liaison encastrement, c’est-à-dire que la liaison entre la douille moteur 9 et la broche 20 est effectuée par un centrage long entre ces deux pièces. Pour cela on installe la goupille 46 afin d’éliminer tout mouvement de rotation et de translation.![]() La liaison complète entre la pièce 9 (douille moteur) et la pièce 20 (broche) est une liaison encastrement. Cette liaison est réalisée par un centrage long entre ces pièces, la goupille 46, montée par serrage, empêche tout mouvement de translation et de rotation de la pièce 9 par rapport à la pièce 20.
La liaison complète entre la pièce 9 (douille moteur) et la pièce 20 (broche) est une liaison encastrement. Cette liaison est réalisée par un centrage long entre ces pièces, la goupille 46, montée par serrage, empêche tout mouvement de translation et de rotation de la pièce 9 par rapport à la pièce 20.
Lors de la reprise du problème avec Michel Chesne, les élèves ont pu aller plus loin dans l’explication du montage, mais le temps a fait défaut ce jour-là pour qu’ils puissent l’écrire."
Commentaire (2020)
Comme d’autres, ces élèves du cours de « méca-philo » pensaient bien pouvoir être libérés du français, cette matière qui, souvent avec les maths, aura été pour eux source de déboires scolaires et d’une orientation en série technologique pas toujours désirée. « Quand on fait de la méca on ne fait pas du français : on n’est pas là pour ça », a-t-on pu entendre. Terrible émergence des effets d’une école qui semble bien ne pas avoir été en mesure d’assurer pleinement sa mission adossée à l’invention de l’écriture, cette technologie de l’intellect comme la nomme Jack Goody.
Pour apprendre à parler il suffit à l’enfant d’être confronté à la pratique d’une langue qu’il s’exerce à parler et à comprendre dans ses interactions quotidiennes avec autrui. Mais pour entrer dans l’écrit il a besoin d’un lieu spécifique, celui de l’école, lieu par excellence de la confrontation à l’écrit, de l’appropriation de savoirs savants dont l’élaboration et la transmission ont fondamentalement partie liée avec l’écriture. Consultable par tous en tout lieu et en tout temps, l’écriture de la pensée la matérialise, l’objective sur divers supports, et devient ainsi un patrimoine universel disponible. Or cette disponibilité ne touche vraiment que ceux qui ont réussi à faire vivre concrètement ce lien immuable entre l’écrit et la pensée, ce qui n’est pas parfaitement le cas de ces élèves de terminale qui pensent, souhaitent même, pouvoir dissocier la langue écrite des savoirs disciplinaires, et laisser tomber ainsi le français quand on fait de la méca.
Langage parlé et écrit
Dans l’interaction verbale, conversationnelle, la présence de beaucoup d’implicites n’empêche pas le sens d’émerger dans la relation langagière des locuteurs. Des mimiques, des regards, des gestes, des tons de la voix, des raccourcis langagiers qui peuvent dire beaucoup avec peu de mots, n’obèrent pas pour autant la possibilité de se comprendre. L’écrit, lui, modifie complètement cette situation en éliminant toutes ces formes d’expressions car il se doit d’être à lui-même son propre contexte d’énonciation : il n’a aucune des « béquilles » de l’interaction verbale. Cela crée l’obligation de changer de rapport au langage, de répondre à des exigences d’autonomie passant par la précision, le respect de contraintes d’efficacité en mesure de produire tout ce qui permet de rendre son discours intelligible et à la hauteur de la demande intellectuelle générée par la consigne que l’on reçoit ou que l’on se donne.
Or c’est justement ce qui manque aux réponses du bac blanc de mécanique, qui sont lapidaires, imprécises, jetées sur le papier sans explications, incapables de permettre au lecteur de se forger une représentation mentale quelque peu élaborée de l’objet traité. Elles sont dans une économie sévère de mots, alors que l’intitulé demandait d’expliciter les éléments de la construction mécanique en jeu, d’en déplier le processus, par le biais notamment de la nécessité de faire plusieurs phrases [3].
Il fallait que les élèves s’arrêtent sur ce qu’implique faire des phrases, même concises, parce qu’elles seules sont porteuses d’explications que quelques mots rapidement déposés sur la copie ne permettent pas de penser. Il leur fallait également être attentif à la présence du mot « comment » qui demande de rendre compte de la façon dont se réalise la construction mécanique en question, et non pas simplement la désigner [4].
Et puis, si la liaison concernée par le sujet est complète, n’y en aurait-il pas une qui ne le serait pas ? Cette question est essentielle car elle conditionne le choix de la conjonction « et » au détriment de « ou » : si l’on n’y prend pas garde, comme cela m’est arrivé, c’est le concept même de la liaison en cause que l’on détruit. Qui ne voit la différence de sens entre "éliminer tout mouvement de rotation et de translation", et "éliminer tout mouvement de rotation ou de translation" ?
Enjeux du rapport scriptural au langage
Dans l’ouvrage cité plus haut, Anne-Sophie Romainville distingue deux versants de la compétence métalangagière : le versant « métalinguistique » et le versant « métadiscursif ». Avant leurs apprentissages scolaires, les enfants savent parler et organiser leurs discours en fonction du lexique et des règles syntaxiques de leur langue, sans conscience explicite de cette organisation. C’est la fonction de l’école de leur permettre d’acquérir cette conscience, essentiellement à partir de leur entrée dans l’écrit. Les connaissances du lexique, de la grammaire et des codes, qui prennent la langue pour objet d’étude, forgent chez les élèves des compétences méta-linguistiques
.
Mais l’école a aussi pour mission d’instruire les élèves des normes de la culture écrite qui s’écartent du mode conversationnel, le dépassent en complexité et en pouvoir heuristique dans tous les domaines. « Les savoirs scientifiques et les énoncés pédagogiques (les consignes écrites notamment) se fondent sur les normes intellectuelles et communicationnelles de la culture écrite. » Interroger les sens générés par la construction des phrases, analyser les modalités de l’élaboration de la pensée dans les textes, prendre en compte tous les éléments du discours pour le « faire parler », le critiquer dans le respect de sa lettre, devient une compétence métadiscursive que les élèves doivent pouvoir s’approprier et utiliser à l’écrit, ainsi qu’à l’oral d’ailleurs, un oral qui finit par s’imprégner des effets de cette compétence.
Cette compétence métadiscursive qui repose sur la construction d’un rapport scriptural à la langue, cette « pratique langagière (qu’elle se réalise à l’écrit ou à l’oral) marquée par les normes inhérentes au développement historique de l’usage de l’écriture », est précisément ce qui fait défaut aux premières réponses de nos élèves de méca-philo. Aussi courtes soient-elles, leurs phrases étaient dans ce cas, correctes syntaxiquement, mais les compétences forgées par un rapport scriptural à la langue efficace, n’étaient pas au rendez-vous. Pour faire émerger ces normes de la culture écrite en mesure de mettre en travail les exigences intellectuelles commandées par les concepts de mécanique, il a fallu construire pas à pas avec les élèves ce qu’impliquait la lecture attentive des demandes de l’intitulé, afin de les amener à pouvoir faire ce qu’ils étaient censés réaliser d’eux-mêmes, puisque nous étions dans une situation d’examen destinée à vérifier des acquis [5].
Une inégalité construite
L’enquête d’Anne-Sophie Romainville souligne combien les compétences métalangagières (métalinguistique et métadiscursive) sont attendues par l’école, combien elles affectent l’ensemble des disciplines, et combien leur degré de développement détermine la valeur scolaire des élèves. Aussi, cette enquête devient vite incontournable si l’on veut comprendre un des processus majeurs par lesquels se fabrique l’inégalité scolaire : elle montre comment les enseignants mobilisent les deux catégories de modes langagiers que sont le mode conversationnel et le mode scriptural, en fonction des élèves auxquels ils ont affaire. Avec les publics populaires ils ont largement tendance à privilégier l’adaptation aux difficultés par la facilitation des tâches en faisant l’économie des exigences des compétences scripturales ; avec les "héritiers" l’accent est mis au contraire sur ces mêmes exigences.
Nous pouvons lire ceci au sujet de ces derniers : « Ces élèves ont intériorisé les enjeux de la communication scripturale. Ils montrent qu’ils ont suffisamment intégré la nécessité d’analyser, de façon minutieuse, l’énoncé des consignes et des questions auxquelles ils doivent répondre. » A contrario, et comme en écho à ce qui s’est passé en méca-philo, les élèves de type « conversationnel », qui n’ont pas réussi à forger les compétences de la communication scripturale « ne traitent pas les textes en réception comme des objets linguistiques à analyser, mais cherchent plutôt à repérer des « mots-signaux ». C’est manifeste dans les exercices de compréhension à la lecture ou dans les difficultés à lire et à répondre aux consignes. Ils ne prennent pas en compte tous les éléments du discours qu’ils ont en face d’eux pour répondre aux tâches scolaires, ce qui les mène à produire des réponses parfois inadaptées, voire totalement absurdes. (…) ils éprouvent de grandes difficultés à adopter une posture réflexive à l’égard du langage, des consignes et des textes. »
Les enseignements majeurs de l’enquête d’Anne-Sophie Romainville peuvent s’écrire ainsi : « Il parait peu contestable que l’institution scolaire contribue activement, du fait des différences de socialisation langagière qu’elle propose, à la reproduction des inégalités sociales. »
Il ne semble pas faire de doute que nos élèves du cours de « méca-philo » se soient trouvés confrontés, lors de leur scolarité, à ce différentiel de prise en charge professorale de l’appropriation des dispositions métalangagières essentielles aux apprentissages. Il ne leur aura pas été permis de comprendre pourquoi il n’est pas pensable de dire que « quand on fait de la techno ou des sciences on ne fait pas du français ». Le court travail que nous avons pu faire avec eux montre à quel point il est possible de les aider à sortir de cette impasse en leur permettant de se confronter aux exigences d’un rapport scriptural au langage, nécessaire à l’investigation des concepts. Il est dommage qu’un travail de ce type n’ait pu se généraliser.
Deuxième extrait du texte de 1996 (Quand un adverbe s’absente)
"J’ai donné à une classe de Terminale Génie électrique un extrait de Race et civilisation de Michel Leiris, en vue d’un travail de type bac qui demande d’examiner comment fait l’auteur pour pouvoir penser ce qu’il dit. Il s’agit donc de rechercher par quel travail de la pensée il en vient à justifier la thèse qu’il défend, ce que la question du bac désigne par la mise au jour de la thèse (ou idée centrale, idée essentielle), et de la façon dont elle est construite. La thèse construite par Michel Leiris se trouvait explicitement avancée par les mots suivants : « qu’il s’agisse d’une découverte ou d’une invention, une innovation n’est jamais absolument créatrice. » Or 9 élèves sur 23 ont lu qu’une innovation n’est jamais créatrice.
Avant de remettre les copies, et après avoir dit aux élèves qu’un problème de lecture était posé dans la classe sans l’indiquer, j’ai écrit au tableau les deux propositions : « une innovation n’est jamais absolument créatrice » et « une innovation n’est jamais créatrice ». Puis je leur ai demandé d’écrire individuellement sur une feuille que j’aillais ramasser et lire immédiatement, la différence de sens qu’il convient de faire entre ces deux propositions. Les réponses ont montré que tous les élèves savaient identifier le sens de la présence ou de l’absence de l’adverbe.
Il est vrai que l’exercice proposé forçait l’attention en isolant quelques mots qui dans le texte étaient tissés avec tous ceux qui les précédaient et les suivaient, et que c’est dans ce tissage que se jouaient la complexité de la pensée de l’auteur et donc sa lecture. Mais il n’en reste pas moins que l’exercice n’a pu que forcer l’attention sur quelque chose qui était su : il ne leur a rien appris vraiment, exceptée la nécessité d’une plus grande présence aux mots.
Reste bien sûr le sens qu’il y a à réfléchir avec le texte de Michel Leiris, qui porte une vive critique du mythe de l’invention ou de la découverte, lequel n’aurait pas d’autre explication que le génie singulier de son auteur ou la rencontre miraculeuse avec le hasard. Ce sens-là, qui est celui de la philosophie (pourquoi faire de la philosophie ?), est bien sûr à construire. Mais un début d’échange comme celui-ci : « J’ai bien le droit de penser que c’est le hasard et le génie qui font les innovations ! » suivi par moi de « Sans doute, mais de quel droit s’agit-il ? », nous confronte à l’historicité fondamentale de toute innovation, et il ne suffit pas de dire combien c’est important pour être entendu. Mais de toute façon nous devons passer par une interrogation sur le mot « droit » utilisé ici par l’élève. On ne peut pas dissocier la construction du sens de la philosophie de la construction du sens dans les énoncés philosophiques, ce qui nous ramène à la nécessité de ne pas « oublier » de lire la présence d’un adverbe dans une phrase. (…)"
Pour ne pas conclure
Le travail sur les mots qui conditionnent l’activité philosophique a fait dire à un élève qui s’adressait à moi avec beaucoup de dépit : « la philo c’est du français en plus approfondi ». Cette remarque ne traduisait pas un début de restauration de la nécessité de s’emparer des mots pour penser. Elle s’apparentait bien plutôt à la démarche qui conduit à dire : « quand on fait de la méca on ne fait pas du français : on n’est pas là pour ça. » D’un côté on fait du français en plus approfondi et « c’est pas bien », de l’autre on n’en fait pas et « c’est tant mieux. » Je pense qu’il ne s’agit là que des deux faces de la même médaille que l’on retrouve dans toutes les disciplines.
Toutefois, au début de l’heure de philosophie qui a suivi le cours de « méca-philo » comme l’ont appelé les élèves, je leur ai demandé d’écrire ce qu’ils en pensaient. Leurs textes étaient marqués par l’idée que ce travail était nécessaire, qu’il aurait dû être proposé dès le début de l’année, car il les avait aidés à mieux sentir l’enjeu d’une lecture non vagabonde et d’une écriture qui ne s’arrête pas au plus succinct. Un élève propose de conduire la démarche « dans toutes les matières, et pourquoi pas dans d’autres domaines en dehors du lycée. » N’y a-t-il pas là au moins le pressentiment qu’il y a à débattre dans la vie et donc à prendre le langage au sérieux pour ce qu’il pense ?"
Commentaire (2020)
En philosophie l’adverbe « absolument » n’a pas été lu, vu par tous, malgré sa taille respectable. Quand un adverbe comme celui-ci s’absente, le contresens absolu n’est pas loin. Comment comprendre un tel aveuglement qui, nous le savons bien, n’a rien d’exceptionnel ?
Aussi surprenant peut-être que cela puisse paraître, je suis convaincue de la possibilité de remonter aux toutes premières années de l’élémentaire pour comprendre un aspect de cet aveuglement : le lien entre ces classes et la terminale n’est pas aussi artificiel, inconsistant qu’il pourrait paraître à première vue, compte tenu de l’écart temporel qui sépare ces deux pôles du cursus. Pour quelles raisons ?
Aujourd’hui la démonstration n’est plus à faire de l’importance de la réussite des années de la primaire dans la suite de la carrière scolaire des élèves, avec une mention particulière qu’il convient de réserver à l’appropriation solide des "fondamentaux". A tort, on a décrié cette place des fondamentaux, au nom d’un supposé renoncement aux ambitions intellectuelles et culturelles supérieures qui doivent être celles de l’école. Or, quelle que soit la hauteur de ces ambitions elles n’ont aucune chance de s’incarner dans une culture scolaire exigeante, sans une appropriation sans faille de ces outils intellectuels de base que sont les fondamentaux. C’est à ce titre que la lecture, l’écriture et les mathématiques, deviennent décisives pour le succès de l’ensemble du cursus scolaire des élèves.
Nos deux classes de terminale de 1996 ont connu un début de scolarité primaire au CP dans les années 1980. La rénovation pédagogique des années 1960-1980 a coïncidé avec le rejet de la syllabique dans l’apprentissage de la lecture, accusée de produire des déchiffreurs non lecteurs : or lire, c’est comprendre, a-t-on martelé. L’usage de cette méthode a donc largement périclité au profit de ce que l’on continue d’appeler la mixte. Comme son nom l’indique, cette méthode se fonde sur plusieurs voies d’apprentissage qui s’appuient, certes, sur du décodage, mais aussi de la reconnaissance globale de mots, de la devinette sous diverses formes, de l’introduction de dessins, d’illustrations, dans le processus de lecture.
Ainsi, face à un texte, les élèves peuvent déchiffrer certains mots, mais d’autres ne leur sont accessibles que par le souvenir de leur forme globale apprise par cœur ; le contexte appelé à l’aide devient un tremplin pour deviner ce qu’ils ne savent pas déchiffrer. Reconnaissant une ou deux syllabes qu’ils connaissent dans d’autres mots, en se fondant sur « c’est comme dans … », ils pourront essayer de deviner le mot entier. L’illustration peut également avoir pour fonction de leur suggérer le ou les mots susceptibles de convenir dans la phrase. Cette pluralité de pistes de lecture hasardeuses, est un formidable facteur de confusions, de méprises, d’empêchements d’accéder efficacement à la matérialité graphique du texte, avec sureté et autonomie. Les hésitations, la lenteur ne peuvent que compromettre l’accès au sens et déboucher sur beaucoup de démotivation.
Je rappelle cette situation car elle continue d’exister dans de très nombreuses classes, créant un rapport aux mots flottant, approximatif et forcément source d’erreurs, qui persiste au-delà du CP, l’avancée nécessaire dans les programmes lors des années suivantes et l’insuffisante remise en question de la méthode mixte, ne permettant pas le plus souvent de restaurer ce qui n’aura pas été très correctement placé.
La nécessité à la fois intellectuelle et éthique de toujours bien lire la lettre d’un texte, commence ici à ne pas pouvoir s’installer rigoureusement et pour longtemps chez les élèves. Alors finalement, au bout du compte, est-ce si important que ça, peuvent-ils se dire, de bien se saisir de la présence d’un adverbe sans lequel la position d’un auteur s’écroule, de ne pas en zapper la lecture ?
Faut-il le rappeler ? La méthode syllabique crée un tout autre rapport aux mots. Les élèves n’ont pas à s’interroger sur la façon dont ils pourraient bien s’y prendre pour lire tel ou tel mot. Dans la mesure où l’accès au sens des mots passe par une lecture précise (on ne peut pas se permettre de confondre « deux » et « doux », « chanter » et « changer », « il s’amuse » et « il joue »), la seule voie est celle d’un déchiffrage efficace, pleinement assuré par un apprentissage exclusivement dédié à la composition syllabique des mots. Sans jamais avoir appris ou deviné le moindre mot, dès la fin du CP les élèves peuvent les lire tous, en ayant bien compris l’importance qu’il y a à ne pas maltraiter leur littéralité. Formés aux exigences de cette posture qui leur offre un socle intellectuel solide, ils peuvent saisir d’emblée le sens des mots déchiffrés connus par ailleurs à l’oral, et poser la question du sens inconnu pour les autres. Un travail ambitieux de compréhension spécifique à chaque texte peut alors s’effectuer sur la base solide d’une lecture efficace, attentive à sa lettre [6].
Ce qui se construit ainsi dans ces toutes premières années d’entrée dans l’écrit, ne manque pas d’être décisif pour les classes à venir. Les exigences de ce type d’apprentissage permettent d’installer très tôt chez les élèves une posture intellectuelle qui ne peut que continuer à avoir des effets tout au long de leur scolarité. Sans lecture attentive, précise et juste des intitulés d’exercices, de problèmes, des documents et des textes relatifs aux différentes disciplines, il n’y a pas d’accès sérieux aux concepts de la culture scolaire arrimée à l’écrit.
Lié à un travail permanent d’écriture qui s’inscrit dans l’apprentissage de cette attention scrupuleuse aux mots, l’apprentissage syllabique de la lecture est le point de départ d’une histoire scolaire qui sait ce que veut dire la nécessaire présence aux mots [7] Le lien entre le CP et la terminale n’a rien d’extravagant : il n’est pas aussi artificiel, inconsistant qu’on pourrait l’imaginer. Glisser sur la présence d’un adverbe à partir duquel se construit un sens précis que l’on ne peut pas s’autoriser à bousculer, a quelque chose à voir, par-delà les années, avec un apprentissage de la lecture qui n’a pas d’emblée produit chez les élèves les compétences premières d’un savoir lire solidement installé dans le respect scrupuleux des mots des textes. Les premières formations de l’école élémentaire finissent par entretenir des liens forts avec les apprentissages du secondaire, en créant des compétences sur lesquelles d’autres, de plus haut niveau peuvent venir s’installer. C’est le cas de la lecture et de l’écriture sur lesquelles doit pouvoir s’appuyer la construction d’un rapport scriptural au langage, nécessaire aux rencontres avec les contenus disciplinaires aux programmes de toutes les années de la scolarité [8].

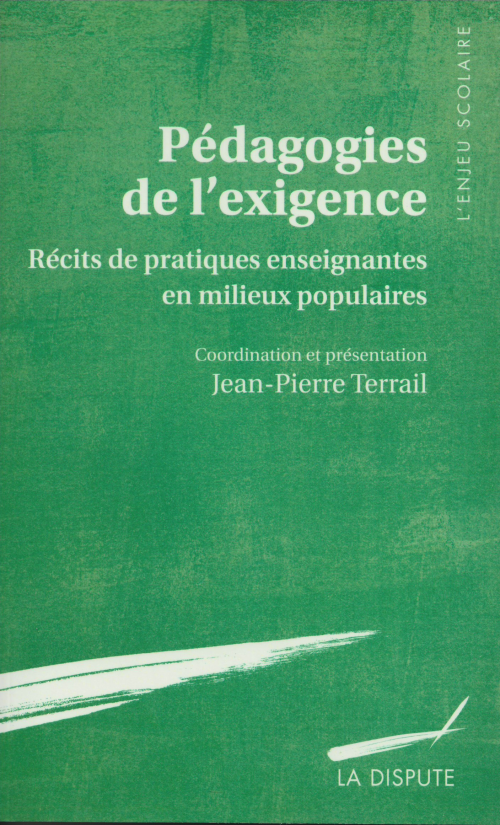
[1] Sciences et techniques industrielles
[2] Génie mécanique
[3] Post-scriptum de mon article de 1996 : « Après le cours de « méca-philo », un élève m’a interpellée avec un véhément « mais je savais tout ça ! » Un de ses camarades lui a répliqué : « Mais le jour du bac, le prof, lui, il ne sait pas que tu sais. Il faut que tu écrives tout, sinon comment il va faire ? » Bien que rapportée aux seuls enjeux de l’examen, cette remarque n’a-t-elle pas quelque chose à voir avec ceux de l’écriture plus généralement ? »
[4] L’ouvrage de La Dispute intitulé Pédagogies de l’exigence. Récits de pratiques enseignantes en milieux populaires contient des récits particulièrement instructifs des moyens didactiques et pédagogiques que les enseignants mobilisent pour répondre aux exigences de leur discipline auprès des publics populaires, en traquant les allant-de-soi particulièrement sources d’incompréhensions. Ainsi en classe de 6e, dans un cours d’histoire géographie par exemple, on ne fait pas l’économie d’un travail sur les mots de la langue qui introduisent les questions à traiter. Prélever des informations, relever, citer, expliquer un passage, montrer, éclairer des informations, déduire etc.…sont des verbes introduisant des activités qui renvoient à des attentes dont les critères sont travaillés, explicités. On traque les allant-de-soi qui laissent trop d’élèves empêchés de bien comprendre ce qu’ils doivent faire pour répondre aux demandes qui leur sont faites.
[5] D’une façon générale, l’ensemble des interventions de l’ouvrage collectif Pédagogies de l’exigence montrent très concrètement à quel point il est décisif de travailler très explicitement les critères de réussite des travaux demandés. C’est la condition pour que les élèves puissent acquérir les moyens conceptuels nécessaires aux activités de lecture et d’écriture dans les différentes disciplines.
[6] Janine Reichstadt, Déchiffrer pour comprendre, GRDS, 2016.
[7] Toujours dans Pédagogies de l’exigence, on pourra lire ce qui se joue en philosophie lorsque l’on fait de la langue un instrument d’élaboration de la pensée afin qu’écrire puisse « servir » à penser plus et autrement.
[8] Dans un ouvrage important, Lire, écrire et être libre. De l’alphabétisation à la démocratie (Odile Jacob, 2016), José Morais montrait que la démocratie n’a d’existence que lorsque le débat est ouvert et approfondi, ce qui suppose des débatteurs ayant les moyens de penser la complexité des sujets débattus. D’où sa réflexion des raisons pour lesquelles la littératie (appropriation de l’écrit dans l’exercice de la pensée) est déterminante, ce qui l’amène à développer l’examen des conditions pédagogiques en mesure de garantir l’apprentissage du bien lire et du bien écrire.

